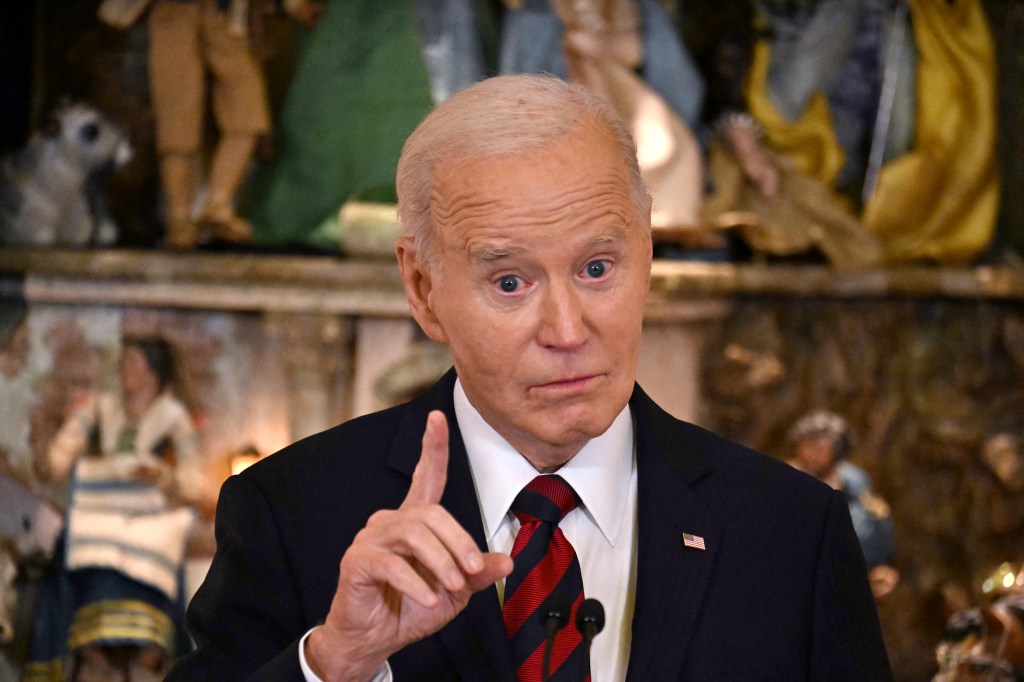Critique de livre
Le mythe de la bonne mère : désapprendre nos mauvaises idées sur la façon d’être une bonne maman
Par Nancy Reddy
St. Martin’s Press : 256 pages, 28 $
Si tu acheter des livres liés sur notre siteLe Times peut gagner une commission de Bookshop.org, dont les frais soutiennent les librairies indépendantes.
Dans « Le mythe de la bonne mère : désapprendre nos mauvaises idées sur la façon d’être une bonne maman », Nancy Reddy juxtapose sa propre histoire brute de maternité précoce avec une tournée des plus grands succès de la science parentale du 20e siècle – ou des pires échecs, selon la façon dont vous regardez. il.
«Avant d’avoir un bébé, j’étais douée pour les choses», écrit Reddy dans son introduction, intitulée de manière séduisante «L’amour est un état merveilleux», une phrase qu’elle emprunte au psychologue Harry Harlow. Harlow a été l’une des premières chercheuses à étudier la « science » de la maternité en laboratoire. Le fait que Reddy fasse des trous dans l’héritage de Harlow alors qu’il poursuit un doctorat à l’Université du Wisconsin, où Harlow a mené ses recherches, fait partie des ironies engageantes du livre.
L’expérience la plus célèbre de Harlow a placé des bébés singes rhésus à côté de cylindres métalliques alternativement enveloppés dans du tissu éponge chauffé ou du fil de fer barbelé. Les bébés s’accrochaient sans faute à la « mère en tissu », « prouvant » à Harlow que la mère idéale était « douce, chaleureuse et tendre… avec une patience infinie ». Reddy s’était imaginée comme une mère en tissu, comme « toutes les bonnes mères qui m’entouraient à Madison », mais son nouveau fils « hurlait », « rugissait », « donnait des coups de pied » et se débattait », ses cris « une urgence dans tout mon être ». corps.” Insomniaque et en proie à une crise d’identité, Reddy passe ses journées à lire les journaux de Harlow : « Si Harlow avait découvert ce qui rend une mère bonne… sur le même campus où j’ai étudié, je voulais aussi l’apprendre. » Ce qu’elle apprend, c’est le pouvoir de la culture de plier la science à sa volonté.
Harlow a défendu une position radicale à l’époque : l’allaitement n’était pas nécessaire pour créer des liens. Cela a incité un journaliste contemporain à déclarer que « n’importe qui peut être mère » – probablement même père.
Sans surprise, ce message n’a jamais été diffusé auprès du public américain d’après-guerre, même si Harlow (et John Bowlby, son ancien collaborateur et à l’origine de la « théorie de l’attachement ») ont vu leurs découvertes couvertes par des magazines largement lus. Les médias ont largement souligné la conclusion selon laquelle les mères devaient être douces et constamment disponibles.

Les scientifiques, eux aussi, semblaient déformer les implications sociales de leurs travaux. Dans un rapport commandé par l’Organisation mondiale de la santé sur la situation des mères et des enfants dans l’après-guerre, après que les garderies financées par l’État aient permis aux femmes d’entrer en masse sur le marché du travail, Bowlby a inscrit la « mère qui travaille » sur une liste des principaux dangers pour les enfants : pris en sandwich entre « famine » et « bombes ».»
Alors que les années 50 reconditionnaient les découvertes de Harlow, la campagne visant à maintenir les mères à l’écart du marché du travail a repensé le laboratoire. Reddy compare le dispositif expérimental des psychologues qui « remplissaient des cages de mères rats… chaque mère isolée avec sa progéniture » – une tentative « d’étudier la maternité dans son essence » – avec le monde de « la femme au foyer de banlieue idéale, seule à la maison avec ses jeunes enfants. » Bowlby et Harlow « ont regardé les animaux qui leur convenaient et ils ont vu ce qu’ils s’attendaient à trouver » : que l’idéal inaccessible de la maternité signifiait que les femmes devaient tout faire seules, tout le temps.
Reddy vise à mettre en lumière la façon dont les sciences sociales ont donné aux mères le « faux choix » entre être tout pour nos bébés ou avoir d’autres ambitions – pour le travail, les amis, quoi que ce soit en dehors de la vie domestique. Et elle souhaite échanger cette mentalité contre une vision de « partage du travail », une version de ce que l’anthropologue culturelle Margaret Mead a appelé « l’alloparentalité ».
C’est ce que la biologiste Jeanne Altmann a découvert en étudiant les babouins à l’état sauvage. Les mères babouins, grâce à la hiérarchie sociale et au toilettage, ont formé des réseaux d’amitiés féminines pour « protéger leur progéniture du danger et identifier les sources de nourriture à partager ». En réfléchissant à une période idyllique de son enfance, Reddy décrit comment sa mère et sa tante nouvellement divorcées partageaient les espaces domestiques et la garde des enfants, leurs quatre filles s’épanouissant dans leurs vieilles maisons délabrées, regardant « The Cosby Show » et faisant leurs devoirs ensemble. Jusqu’à ce que les deux femmes se remarient et emménagent leurs filles avec leur nouveau mari. « Nous étions des babouins », écrit Reddy avec une tendresse triste. “Ensuite, nous étions à nouveau des rats.”
« Le mythe de la bonne mère » est rempli de phrases mémorables comme celle-ci (« Certains hommes vont vraiment inventer toute une discipline académique au lieu de suivre une thérapie », écrit drôlement Reddy à propos de Bowlby). Mais ce qui empêche l’auteur d’être trop intelligent ou désinvolte, c’est la rigueur avec laquelle elle examine la fréquence à laquelle les études universitaires sur la maternité s’appuient sur des conclusions d’avance à motivation sociale, poussées par des hommes qui négligent souvent leur propre famille.
Le parcours de Reddy est également personnel : son plaidoyer en faveur d’une maternité collaborative s’inspire de sa terrible solitude, si courante en Amérique, au cours de sa première année en tant que maman. Elle montre comment les visites occasionnelles qu’elle reçoit de ses amis et de sa famille accentuent son isolement général, et comment une femme participant à un cours d’exercices post-partum la voit lorsqu’elle se sent comme un échec invisible et noyé.
Comme les bonnes mères mythiques qu’elle cherche à déconstruire, Reddy est blanche, hétéro et aisée, élevant ses enfants dans une maison biparentale. Les difficultés des mères qui n’occupent pas la même position sociale et les rôles que jouent la race et la classe sont remarquablement absents du livre.
Mais l’accent mis sur les Blancs aisés contribue à faire valoir le point de vue de Reddy. Tout ce que Reddy vit, à partir du moment où elle déverrouille son soutien-gorge d’allaitement pour exposer ses mamelons « crus et craquelés » au corps de son bébé contorsionné par des cris inexpliqués, est une partie ordinaire de ce qui, aux États-Unis, est considéré comme une situation parentale souhaitable. Lorsque Reddy nous dit qu’elle « était un mammifère qui saignait, qui fuyait, qui pleurait dans la section des produits » et qui a à peine survécu, elle exprime l’expérience d’innombrables femmes à travers le spectre de la maternité américaine. Elle attribue sa survie à sa capacité à demander et à recevoir de l’aide de la communauté de femmes qu’elle avait rassemblée autour d’elle, avec pour habitude de toujours satisfaire ses besoins fondamentaux – des soins de santé, de la nourriture et un logement décents. S’ils ne l’avaient pas été – eh bien, qu’aurait-il pu se passer alors ?
Cette question résonne lorsqu’un jour d’été, la sœur de Reddy l’appelle pour lui dire qu’une femme qu’ils connaissaient en grandissant s’est suicidée dans un état de psychose post-partum. «Je sais que tu traverses une période difficile», dit la sœur de Reddy en pleurant. Reddy lui assure que même si c’est difficile, ce n’est pas « comme ça » – elle va « bien », ou assez bien. L’autre femme, qui ne va pas bien, devient l’ombre de Reddy alors que le livre nous propulse à travers la première année d’apprentissage de son fils à se retourner, à se relever, à marcher et à parler. Les sentiments d’invisibilité de Reddy sont rendus d’autant plus réels par l’absence définitive de son sosie.
Parfois, j’aurais aimé que « Le mythe de la bonne mère » soit un mémoire traditionnel, car les sections personnelles sont si convaincantes. Mais la juxtaposition narrative avec une recherche intensive sert un objectif. En ancrant les normes inaccessibles qui la narguaient dans la science bidon du siècle dernier, Reddy s’en prend aux structures de pouvoir sous-jacentes, notamment l’enseignement supérieur et la suprématie blanche. « Le mythe de la bonne mère » se termine avec la pandémie ; Alors que les murs se referment sur Reddy, elle écrit : « J’ai finalement craqué. » Beaucoup d’entre nous l’ont fait. Elle résout ce problème en insistant pour que son mari partage la charge, une transition qui, selon elle, se produit après des années.
Je crois Reddy et j’admire son avertissement selon lequel «un homme qui ne peut vraiment pas, ou ne veut pas, apprendre à préparer un déjeuner… n’est pas un homme avec qui vous devez rester marié.» Son livre montre clairement combien de travail il nous reste à faire pour démêler les notions de bonté et de travail prescrit de la maternité.
Emily Van Duyne est professeure agrégée d’écriture à l’Université de Stockton et auteur de « Loving Sylvia Plath : A Reclamation ».