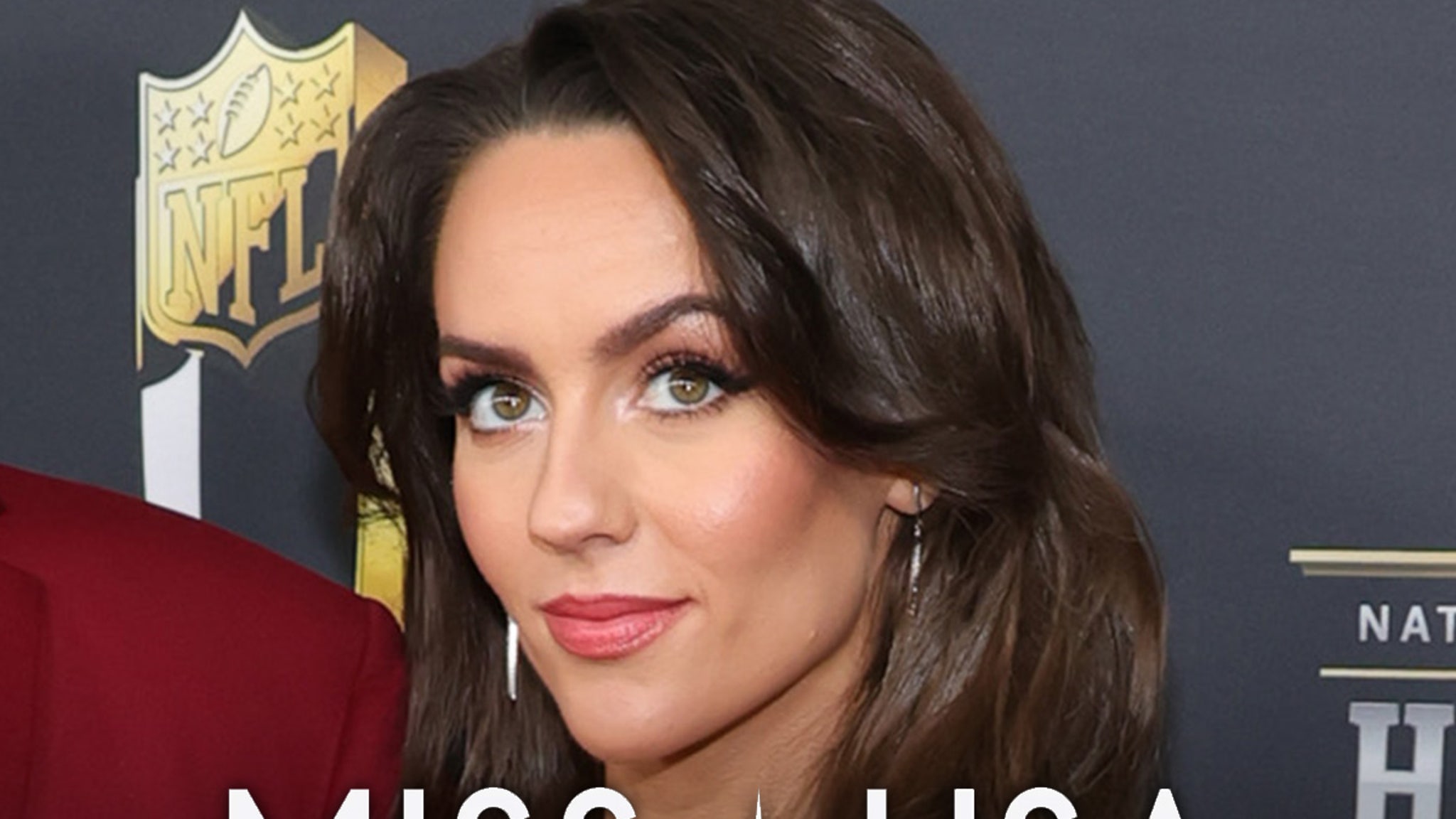“La défense est trop défensive”, a récemment noté le président Trump, alors qu’il annonçait que le ministère de la Défense serait renommé du ministère de la Guerre.
Une rhétorique plus agressive peut conduire à une action plus agressive, et c’est une grave préoccupation. Mais l’éloignement de Trump du mot «défense» est également l’occasion pour les Américains de compter plus honnêtement avec l’utilisation du pouvoir militaire par la nation. Le «ministère de la Guerre» traverse la rhétorique que l’Amérique utilise depuis des décennies pour affirmer qu’elle défend la paix même si elle fait continuellement des guerres.
La «défense» rend les budgets militaires intouchables, car la défense de la nation ne semble pas facultative. Mais la «guerre» semble plus coûteuse et peut-être plus difficile à justifier. Le ministère de la Défense a obtenu son nom en 1949, et les dépenses de l’armée ont augmenté de manière exorbitante dans les années suivantes – triplé en 1951, et représentant les trois quarts du budget fédéral en 1955.
Le budget de 2025 du ministère de la Défense est de 849,9 milliards de dollars. Les Américains qui s’opposent à une telle dépense peuvent trouver plus facile de se rallier à la coupe des fonds d’un ministère de la Guerre.
Le nouveau nom proposé exprimerait également la continuité de l’histoire américaine – mais pas l’histoire que Trump a en tête. Le ministère de la Guerre d’origine a été créé par le Congrès en 1789, malgré les manifestations de ceux comme Thomas Jefferson qui pensaient que les États-Unis ne devraient maintenir une armée professionnelle qu’en temps de guerre.
Le département nouvellement formé a été immédiatement responsable des relations américaines avec les Amérindiens. Il a répandu un archipel de forts de l’armée vers l’ouest et a déterminé le nombre de troupes devait les garder. Les colons ont suivi ces forts, donnant au secrétaire à la guerre un rôle décisif dans la colonisation des États-Unis continentaux – et au-delà.
«Le fait que les États-Unis soient une ancienne colonie ne l’empêchait pas d’acquérir des colonies», observe l’historien AG Hopkins. Le plus peuplé de ces biens était les Philippines, que le ministère de la Guerre a été chargé d’envahir en 1899. Il l’a fait en déployant les mêmes stratégies brutales qu’elle avait utilisées contre les Amérindiens.
La brutalité s’est poursuivie à l’époque du «ministère de la Défense». Mais les États-Unis ont euhemisé sa récente guerre avec des termes tels que la contre-insurrection, l’assistance à la sécurité et le maintien de la paix. Et malgré le déploiement militaire américain sur presque tous les continents depuis les années 40, la Seconde Guerre mondiale était la dernière fois que les États-Unis ont officiellement déclaré la guerre. Cette période était dans l’esprit de Trump lorsqu’il a décidé de renommer le département. “Nous avons eu une histoire incroyable de victoire quand c’était” Department of War “”, a-t-il déclaré.
Mais l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale n’est pas le résultat d’une conversation de guerre à grande humeur. Il reposait plutôt sur la rhétorique de la légitime défense. Même après Pearl Harbor, le président Franklin D. Roosevelt s’est rendu compte qu’il devait travailler dur pour maîtriser le soutien pour rejoindre la guerre. Il devrait convaincre le public que l’attaque du Japon dans le Pacifique était vraiment une attaque contre l’Amérique elle-même.
Pourquoi le public avait-il besoin de convaincre? L’événement que nous appelons de manière réductive «Pearl Harbor» s’est en fait accompagné d’attaques contre de nombreux possessions coloniales américaines dans le Pacifique. Le premier projet du discours de Roosevelt «Day of Infamie» se référait non seulement au bombardement d’Hawaï, mais aussi à celui des Philippines.
En fin de compte, Roosevelt a fait de Pearl Harbor l’objectif du discours, ne mentionnant que les autres attaques dans une liste à la toute fin. Il était inquiet, soutient l’historien Daniel Immerwahr, que les Américains pourraient ne pas accepter de sacrifier leur vie pour défendre les territoires étrangers dont ils étaient à peine conscients. Les sondages d’opinion à l’époque ont révélé qu’à la plupart des Américains, seul Hawaï – avec sa grande population blanche – semblerait assez proche pour représenter une partie de la patrie.
La défense de la patrie est une idée puissante – une idée qui a été consacrée à la dénomination du ministère de la Défense après que la Seconde Guerre mondiale ait été gagnée. Mais même alors, le nouveau nom était considéré comme un euphémisme. Le journaliste Hanson Baldwin pensait, par exemple, que c’était le symptôme «d’un âge où défendre est d’attaquer».
Le mot «défense» a aidé à masquer le travail continu de tenir des territoires à l’étranger et de détourner l’attention de la façon dont cet empire a été acquis. Le nom «Département de la guerre», en revanche, révèle que Trump pense plus comme ceux qui ont nommé l’invasion et le pillage comme des objectifs explicites de politique étrangère. Trump considère la politique mondiale comme une saisie des terres, que ce soit par commerce ou par conquête, comme il réfléchit à l’achat du Groenland et à faire du Canada le 51e État.
L’idée d’acquérir le Canada, du moins, n’est pas nouvelle: c’était une ambition du gouvernement américain jusqu’en 1871. Bien qu’elle soit abandonnée comme politique à ce moment-là, l’idée a continué à apparaître dans les discussions sur l’impérialisme. En 1889, le journaliste Albert G. Browne – considéré comme libéral pour l’époque – a écrit dans l’Atlantique mensuel: «Nous allons certainement absorber un jour le Canada.»
Le changement de marque de Trump peut glamour l’âge où l’Amérique a déclaré avec confiance la guerre, mais cela aide également à éliminer la façade de la politique militaire comme protection de la paix. Ce changement peut permettre un débat plus transparent sur la question de savoir si la puissance militaire américaine doit être financée et déployées sans limite à travers le monde.
Trisha Urmi Banerjee et Nathaniel Zetter enseignent à l’Université de Cambridge.
(Tagstotranslate) Département