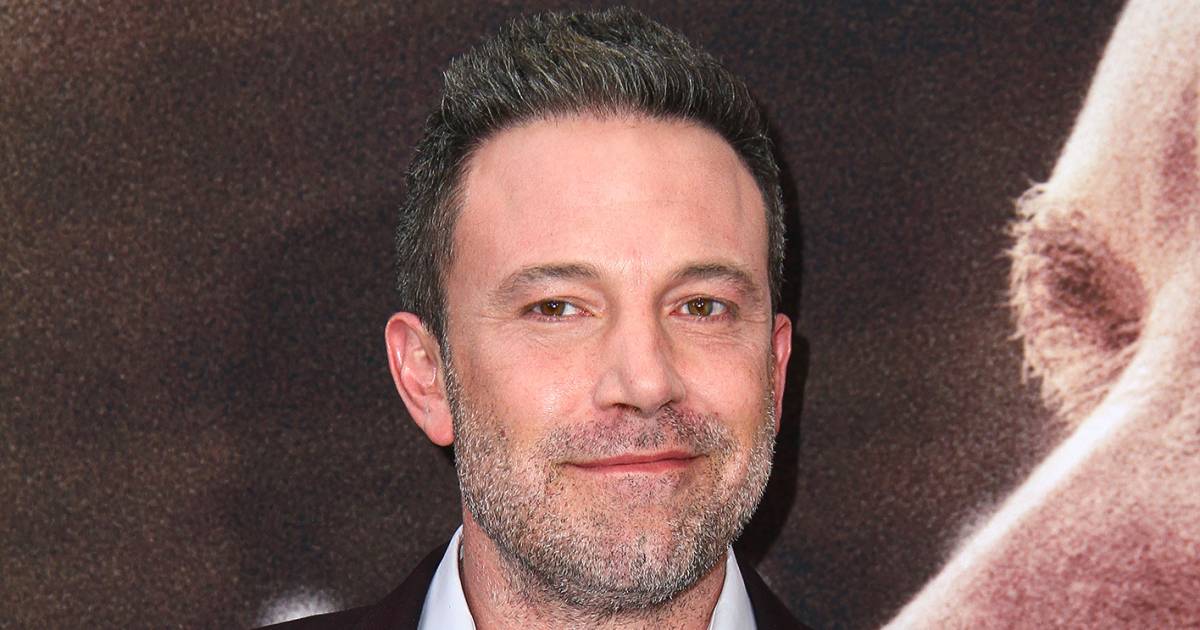En parcourant Twitter un jour très tôt dans la pandémie de COVID-19, j’ai vu un tweet qui m’a semblé à la fois sans joie et vrai. “Dans des milliers d’années, tout ira bien pour les roches”, a plaisanté le comédien Donni Saphire. Cela m’a rappelé un dicton que ma mère me répétait quand j’étais enfant, chaque fois que je me laissais entraîner par un contretemps trivial ou autre – mauvaise journée de cheveux, fête manquée, camouflet dans le couloir. « Dans l’ensemble des choses, disait-elle d’une voix traînante, cela ne signifie tout simplement pas. »
Bien sûr, c’était manifestement faux et, en plus, irritant. Pour l’adolescent, comme pour le tout-petit, il n’y a pas de grand schéma ; il n’y a que le maintenant, et cela signifie absolument.
Pourtant : tout ira bien, dans le grand schéma des choses, pour les roches. À cette époque où nous nous trouvons enfermés dans un bégaiement calamiteux perpétuel, au bord de la catastrophe, pourquoi ne pas essayer d’imaginer les choses du point de vue immobile et dur comme le diamant du règne minéral ? Cela ne pouvait pas faire de mal.
Je ne suis pas le premier à le suggérer. Les poètes ont toujours utilisé les pierres pour exprimer le caractère insensé et muet du défunt. Mais en parlant de la mort, Emily Dickinson recourt à l’imagerie de la pierre de manière plus cohérente, plus effrayante et plus littérale peut-être que n’importe quel autre poète de langue anglaise. « C’était chaud – au début – comme nous », par exemple, est une description médico-légale d’un corps en train de subir une rigidité cadavérique, se transmutant de personne en chose : d’abord la « copie(s) pierre(s) du front », puis les yeux se figent. comme un « Skater’s Brook », jusqu’à ce que le corps « tombe comme Adamant » dans la tombe. L’« indifférence multipliée » du cadavre prend une tournure plus joyeuse dans « En sécurité dans leurs chambres d’albâtre », où Dickinson imagine les morts comme autant de dormeurs « intacts » nichés en sécurité dans leurs lits de pierre.
Dickinson est fasciné par l’imperméabilité de la pierre, par sa persistance insouciante à travers les âges. « Comme elle est heureuse la petite pierre / Qui se promène seule sur la route », écrit-elle. Quelle importance peut avoir la durée d’une vie humaine, semble-t-elle se demander, lorsqu’on la mesure à l’aune de vastes étendues de temps incalculables et indénombrables à l’échelle du granit ?
Parmi les effets secondaires des antidépresseurs connus sous le nom d’ISRS – inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine – il y a ce que les psychologues appellent « l’affect émoussé » ou « aplati », une gamme réduite d’expression émotionnelle disponible pour le patient. J’ai pris et arrêté – principalement – des médicaments ISRS depuis ma dépression nerveuse provoquée par mes études supérieures et mon premier diagnostic de dépression à l’âge de 24 ans. En d’autres termes, depuis plus de 30 ans.
Lorsque j’ai commencé à prendre ce médicament, il n’a pas complètement supprimé mon émotivité, mais a simplement pris le pas sur son pouvoir paralysant. Je n’étais plus si paniqué que je ne pouvais pas quitter le canapé, ni si en larmes que je ne pouvais pas sortir du lit. Mais au fil des années, j’ai remarqué que j’étais en fait moins apte à ressentir. Là où autrefois l’inquiétude quant au sort de mon âme (en tant qu’enfant) ou de ma santé mentale (à l’adolescence et dans la vingtaine) m’avait consumé, avec le temps, je suis devenu de plus en plus incapable de ressentir quoi que ce soit à propos de l’avenir, du moins quand il est venu. à ma propre personne. Quand j’ai regardé devant moi, c’était sans aucun désir ni appréhension marqués – un peu comme les dormeurs de pierre de Dickinson, « Intouchés le matin / intacts à midi ».
Pour être honnête : même avant le Prozac, je n’avais pas été porté sur une intensité passionnée, ce qui n’était pas la prédilection de ma famille. Pourtant, au-delà de la tendance génétique à l’absence d’affect que j’aurais pu ressentir naturellement, je crois que le Prozac a eu un effet engourdissant supplémentaire.
L’air d’indifférence neutre avec lequel je semblais aborder ma propre vie est devenu un sujet de curiosité médicale lorsque j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein à l’automne 2019. Parmi les nombreux médecins que j’ai consultés se trouvait un psychiatre chargé de vérifier comment je m’en sortais. mentalement avec la perspective d’une mastectomie et d’une chimiothérapie. J’ai raconté les faits saillants de mes antécédents psychiatriques pendant qu’elle hochait la tête et griffonnait des notes. “Mais comment te sens-tu ?” insista-t-elle. «Je me sens bien, vraiment», répétais-je sans cesse, souriant d’un air d’excuse, conscient que quelque chose dans ma réponse à l’effondrement de mon propre corps n’était pas à la hauteur de ce à quoi elle s’attendait. Lorsque j’ai lu mon rapport clinique par la suite, j’ai trouvé ceci : « La patiente semble parler avec un certain isolement d’affect qui est perceptible (discutant de son diagnostic et de sujets sensibles avec peu ou pas de réactivité émotionnelle). »
La capacité de sensation, ou ce que mon médecin appelait « réactivité », fait partie des critères philosophiques les plus anciens et les plus fiables permettant de juger de la place d’une créature dans la hiérarchie des êtres vivants. Aristote a créé une taxonomie des « âmes » pour décrire une échelle biologique ascendante : les légumes étaient capables de croître et de se reproduire, ce qu’Aristote appelait une âme « nutritive ». Les animaux, un échelon plus haut sur l’échelle, présentaient les propriétés spirituelles des plantes et étaient en outre capables de ressentir, de bouger et de digérer. Enfin, les humains arrivaient en tête du classement en tant que seuls êtres vivants dotés d’une « âme rationnelle » ou de la capacité de penser. Les minéraux ne faisaient absolument pas partie du champ de la vie.
En lisant le rapport du psychiatre, je me voyais glisser le long des échelons de la Grande Chaîne de l’Être : dépasser l’animal, dépasser le végétal, atterrir avec un bruit sourd parmi les minéraux.
Et si, comme Dickinson, nous pouvions nous apprendre à envisager la possibilité d’une échelle non humaine – une échelle géologique – comme une autre façon de voir le monde ?
Dickinson se concentre sur la mort pierreuse et insensible, oui. Mais elle utilise aussi le point de vue des rochers pour se rapprocher de certains états mentaux intérieurs qu’elle a vécus de son vivant, périodes qu’elle ressentait comme une sorte de mort dans la vie. Dans « After Great Pain », la narratrice de Dickinson décrit un état suspendu de torpeur glacée qui la saisit au lendemain du chagrin. Le narrateur se déplace dans la vie de manière mécanique : « Indépendamment des adultes, / Un contentement de quartz, comme une pierre. » Dans « It Was Not Death », raconté du point de vue de ce qu’elle appelle le chaos lui-même, « sans arrêt » et « cool », Dickinson évoque un « vide » inerte et aqueux avant que Dieu ne crée la forme à travers laquelle nous reconnaissons notre être humain. monde centré. De tels états mentaux impersonnels – contentement de quartz, chaos cool – étaient clairement terrifiants pour Dickinson. Mais ils étaient aussi instructifs, des ouvertures à travers lesquelles nous pouvions apercevoir le monde sans nous.
Les minéraux et les organismes vivants évoluent conjointement, la majorité des quelque 5 000 organismes actuels espèces minérales documentées le résultat, d’une manière ou d’une autre, de 3,8 milliards d’années de l’activité biologique sur la planète. Certains des cristaux les plus baroques qui existent, comme la malachite, se forment par oxydation de minéraux sulfurés de cuivre ; ces cristaux sont devenus une possibilité chimique lorsque l’évolution de la photosynthèse des algues a inondé l’atmosphère terrestre d’oxygène il y a 2 milliards d’années. Du côté organique de l’équation, les premiers invertébrés ont replié les cristaux d’aragonite et de calcite de l’océan dans leurs propres cycles métaboliques pour construire des dents, des os et des coquilles.
Quand j’ai parlé à un ami de mon incapacité à penser à l’avenir ou à m’inquiéter, il m’a dit : « N’est-ce pas juste un autre nom pour la sagesse ? La « littérature de sagesse » est en effet souvent présentée comme sage parce qu’elle incite les lecteurs à réfléchir aux questions d’échelle, à la nature transitoire de toute vie dans le grand schéma des choses.
Sagesse ou lobotomie chimique, sagacité ou déficit cérébral, qui peut le dire ? En attendant, je m’intéresse à ce que je pourrais faire de cette lentille singulièrement semblable à du quartz.
Voir comme une pierre, au sens d’Emily Dickinson, ce n’est pas se montrer froid face à la souffrance d’une Terre sensible. Au contraire : il s’agit de ressentir ces grands arcs qui lient entre eux les atomes du cosmos, y compris – mais sans s’y réduire – la petite parcelle de poussière d’étoile empruntée à notre propre espèce.
Ellen Wayland-Smith est professeur au programme d’écriture de l’USC et auteur du prochain ouvrage « La science des choses dernières : essais sur les temps profonds et les limites du soi », à partir de laquelle ceci est adapté.