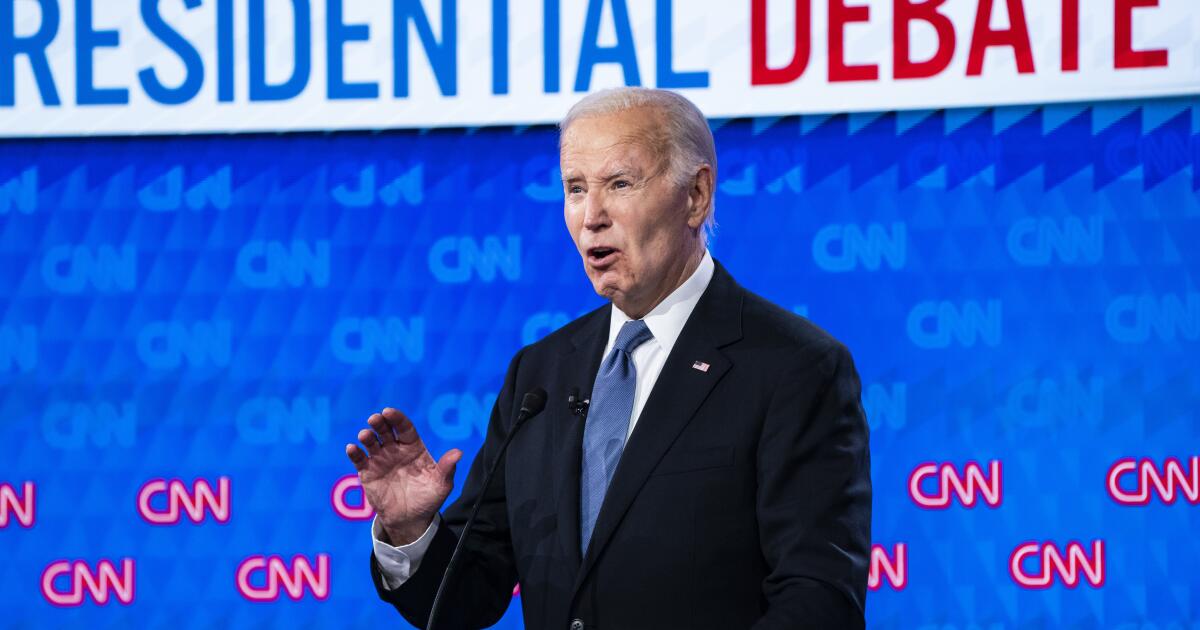Haïti : des Cagoulards aux Gangs, l’histoire d’une violence systémique
PAR DAN YOO
Depuis 1957, Haïti n’a cessé de voir la violence gangrenée par des élites politiques et économiques. De l’époque des cagoulards de François Duvalier aux gangs d’aujourd’hui, retour sur une descente aux enfers nourrie par des décennies de corruption et de cynisme.

À la veille de son élection triomphale en 1957, François Duvalier promettait de redonner aux masses noires d’Haïti leur place dans une société longtemps dominée par une élite mulâtre. Pourtant, derrière le discours de rédemption nationale, il réveillait un spectre que beaucoup croyaient disparu : celui de la violence politique organisée.
À l’époque, Haïti semblait vouloir rompre avec les pratiques brutales du passé. Sous Dumarsais Estimé (1946-1950), le pays s’était engagé dans une ère de modernisation : la construction du Bicentenaire, l’Expo internationale de 1949, ou encore le lancement du barrage de Péligre incarnaient une volonté claire de rompre avec l’ère des Zinglins et des Cacos — ces bandes armées des décennies précédentes.
Mais François Duvalier inversa brutalement cette trajectoire. Dès ses premiers mois au pouvoir, des hommes cagoulés — les « Cagoulards » — sèment la terreur contre ses opposants. Ils marquent les débuts d’une méthode politique qui ne quittera plus jamais la scène haïtienne : l’instrumentalisation de la violence à des fins de pouvoir.

En 1959, la terreur se structure : naît la Milice de Volontaires de la Sécurité Nationale, surnommée par le peuple les « Tontons Macoutes », en référence au croque-mitaine du folklore haïtien. Sans foi ni loi, surarmés et tout-puissants, les Macoutes deviennent l’incarnation de l’État lui-même, fusionnant dans une même terreur la force privée du tyran et l’autorité publique. La peur devient un mode de gouvernance.
Après la chute de la dynastie Duvalier en 1986, Haïti aurait pu espérer un retour à l’État de droit. Mais les promesses démocratiques s’effondrent très vite. Sous les gouvernements militaires, une nouvelle génération d’hommes de main émerge : les Attachés — paramilitaires sans uniforme, souvent issus de l’armée ou de ses réseaux, qui sèment la terreur pendant les années de transition.
Le coup d’État de 1991 contre le président élu Jean-Bertrand Aristide donne naissance à l’un des épisodes les plus noirs de l’histoire récente : la création de la Frappe (Front pour l’Avancement et le Progrès Haïtien), une milice soutenue par des secteurs économiques et appuyée par l’armée. La brutalité devient industrielle.

Quand Aristide revient d’exil en 1994, les espoirs sont grands. Mais l’érosion rapide des institutions et la méfiance envers les forces de sécurité poussent le pouvoir à s’appuyer sur des « Chimères »groupes armés fidèles, qui exercent leur propre forme de terreur au nom de la révolution populaire. La violence, instrumentalisée, entre définitivement dans la vie quotidienne.
Le XXIe siècle aurait pu marquer une rupture. Mais au contraire, il voit la généralisation de la terreur urbaine : les gangs prennent le relais. Sous les présidences de Michel Martelly et de son successeur Jovenel Moïse, issus de la mouvance Pelerles bandes armées prolifèrent, parfois avec le soutien tacite ou direct de figures du pouvoir. Le phénomène « Viv Ansanm », alliance informelle entre groupes armés, est l’aboutissement d’une politique où les armes remplacent les urnes et où la violence supplante l’État.
Ce chaos n’est pas né d’une génération spontanée. Il est le produit d’une succession méthodique de compromissions, où chaque gouvernement, sous prétexte de maintenir l’ordre ou de conserver le pouvoir, a préféré pactiser avec la violence plutôt que de la combattre.

Haïti est aujourd’hui l’héritière tragique d’une politique cynique : celle où la force brutale remplace la légitimité, et où l’intérêt privé de quelques-uns passe avant la survie de la nation.
Tant que la violence restera un instrument politique au service d’élites prédatrices, la reconstruction de l’État haïtien restera un mirage.
Et yoo