Critique de livre
La carte indienne : qui peut être autochtone en Amérique
Par Carrie Lowry Schuettpelz
Fer à repasser : 304 pages, 29,99 $
Si vous achetez des livres liés sur notre site, le Times peut percevoir une commission de Librairie.orgdont les redevances soutiennent les librairies indépendantes.
« La carte indienne » commence par une énigme statistique : lors du recensement américain de 2000, 4,1 millions de personnes ont indiqué un héritage amérindien. Mais en 2020, ce chiffre était passé à 9,7 millions. Et pourtant, il n’y a pas eu de baby-boom.
Voici un autre problème : il n’y avait qu’environ 1,9 million de membres de tribus inscrits dans les États-Unis contigus en 2020.
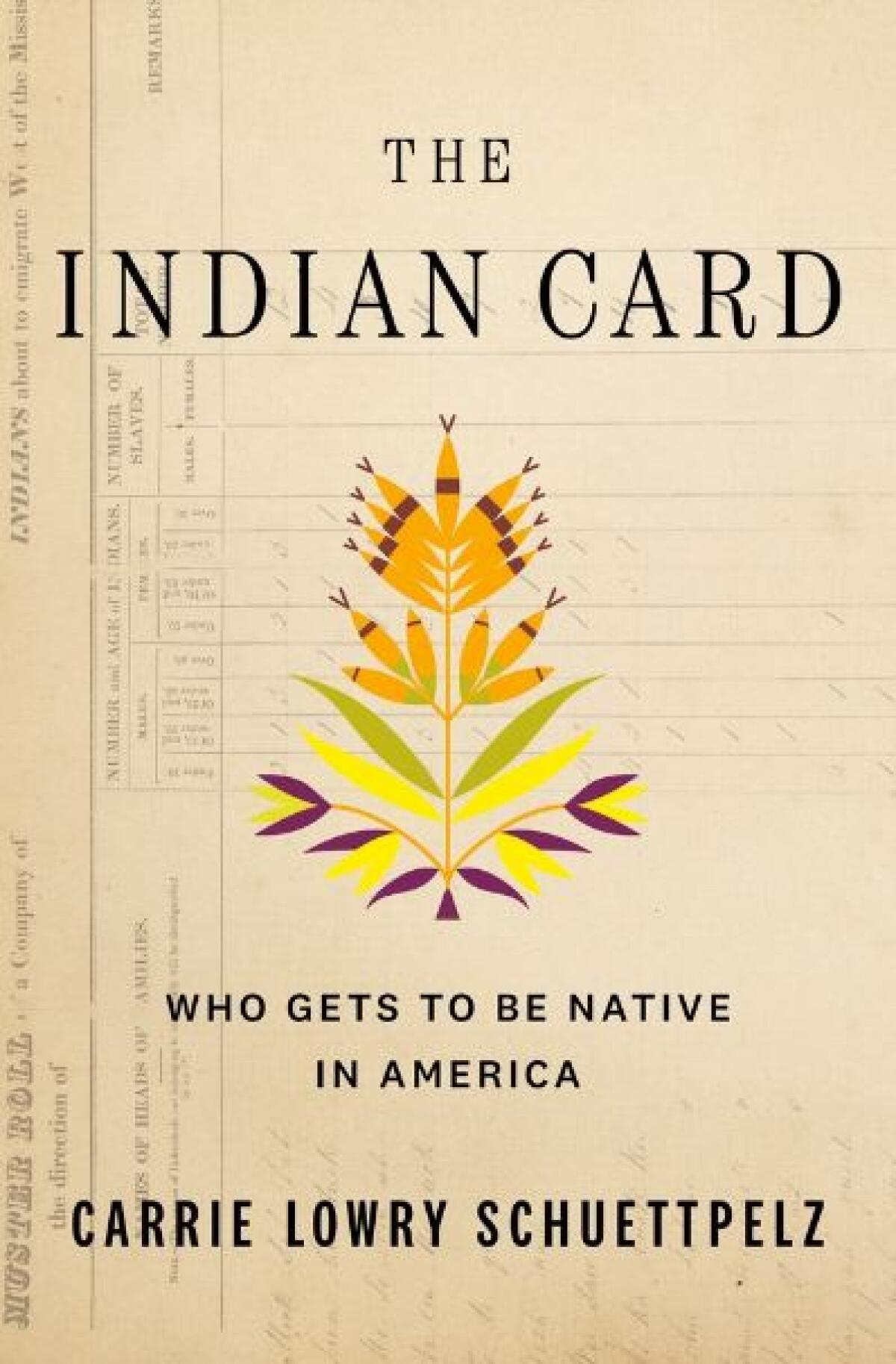
Dans ces des écarts béantsl’auteur Carrie Lowry Schuettpelz a vu le besoin de raconter des histoires. Membre inscrit de la tribu Lumbee de Caroline du Nord qui a servi dans l’administration Obama, Schuettpelz est un expert de la politique autochtone et de l’itinérance. Les données ont été son stock de commerce. Alors, comment trouve-t-elle un sens à ces anomalies ? En trouvant le contexte.
« La carte indienne » amplifie les récits de nombreuses personnes qui ont été affectées par une notion erronée d’identité universelle. Par la suite, on peut commencer à imaginer comment le nombre d’Américains revendiquant une identité autochtone pourrait fluctuer par millions, même en une décennie.
Schuettpelz recueille les témoignages d’individus sur les liens qui les unissent à leur tribu et sur la manière dont l’appartenance les fonde. Elle raconte également des expériences qui ont conduit à une plus grande aliénation et à un plus grand isolement, certaines personnes se voyant refuser l’appartenance à des tribus auxquelles elles s’identifiaient ou des tribus entières se voyant refuser la reconnaissance fédérale.
Pour être significative, une conversation sur l’héritage amérindien doit avoir lieu à ce niveau de granularité, écrit Schuettpelz, car il existe 347 tribus reconnues dans les États-Unis contigus : « Traiter l’Amérique amérindienne comme un monolithe, c’est un peu comme revendiquer son intérêt pour l’héritage amérindien. « Culture asiatique. » Il n’y en a pas qu’un.
Le gouvernement fédéral dispose de ses propres processus complexes de reconnaissance des tribus. Quel que soit ce statut, chaque tribu et nation peut déterminer qui inclure. Les décisions pourraient dépendre de la descendance patrilinéaire ou matrilinéaire, du nom d’un parent direct sur une liste fédérale des membres de la tribu du XIXe siècle ou d’autres documents liant un individu à une tribu. Certaines tribus déterminent la fraction de la lignée qui justifie l’adhésion. Historiquement, d’autres ont défini leur peuple à travers des traditions orales ou des langues partagées, ou encore par consanguinité ou habitation.
Les questions d’identité sont personnelles pour Schuettpelz. Elle a grandi dans l’Iowa, à plus de mille kilomètres du territoire de la tribu Lumbee de Caroline du Nord. Ses parents l’ont inscrite comme membre de la tribu lorsqu’elle était petite. Les voyages de sa famille en Caroline du Nord l’ont amenée dans une communauté de parenté, une permanence liée à une patrie, des histoires personnelles qui lui ont donné un sentiment d’appartenance qui contrastait avec l’isolement de sa famille dans l’Iowa.
Au début du livre, elle essaie de prendre une décision concernant ses deux jeunes enfants. Que signifierait dans leur vie le fait d’être reconnu pour leur parenté au sein de cette tribu ? En quoi est-il important que la tribu Lumbee de Caroline du Nord ne soit pas encore reconnue par le gouvernement américain ?
Au cœur de la reconnaissance tribale se trouve la notion de souveraineté, un mot que ce livre décrit comme un langage d’amour chargé de signification culturelle et historique. En termes plus simples, il s’agit de la capacité d’une tribu à se gouverner elle-même, à exercer sa juridiction sur ses terres, le droit de déterminer son propre avenir. Dans l’histoire sanglante de ce pays, la souveraineté tribale est un témoignage de survie et une source de fierté.
Pour le gouvernement fédéral, cependant, définir les tribus et compter les Amérindiens n’est devenu crucial qu’en raison des politiques brutales du président Andrew Jackson dans les années 1830, expulsant les individus qui avaient été recensés sur les « listes d’appel ». Mais les listes elles-mêmes étaient de mauvaise qualité, souvent basées sur des observations superficielles de marqueurs raciaux supposés tels que la couleur de la peau, la structure du visage et la texture des cheveux, ou sur des listes de membres fournies par les chefs tribaux en vertu des termes du traité.
Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a lancé une nouvelle politique qui a simplement mis fin à la reconnaissance de centaines de tribus, supprimant toute revendication de souveraineté tribale sur leurs terres. Malgré un effort ultérieur pour corriger ce problème, Californie à elles seules, 12 tribus ont été dissoutes et leurs droits tribaux n’ont toujours pas été rétablis. La lutte d’une tribu pour la reconnaissance peut être ardue.
Les relations des individus avec leur propre identité autochtone sont compliquées à leur manière. Pensez aux près de 8 millions d’Américains qui se sont identifiés comme autochtones lors du recensement de 2020 mais ne sont pas membres de tribus reconnues. Pourquoi cocheraient-ils la case « Autochtone » ? Certains appartiennent à des tribus non reconnues. Certains peuvent adhérer à des traditions familiales non vérifiées, peut-être celles d’un lointain ancêtre Cherokee. D’autres pourraient revendiquer une identité minoritaire dans l’espoir d’un traitement préférentiel lors de l’embauche ou de l’admission à l’université, ou pour un cachet culturel. On ne sait pas si la plupart de ces personnes descendent des Américains précolombiens.
Historiquement, certains « prétendants » sont motivés par la cupidité. Un vieux mythe pernicieux veut que le fait d’être Amérindien apporte d’abondantes subventions fédérales ou des revenus provenant des droits miniers ou des casinos – pensez aux « Tueurs de la Lune des Fleurs » et à l’argent du pétrole Osage. Les bureaux tribaux reçoivent des appels d’étrangers revendiquant l’ADN amérindien et exigeant une partie de cet argent mythique, relaie Schuettpelz.
La réalité, cependant, est que les Amérindiens connaissent des taux de pauvreté et d’itinérance bien plus élevés que ceux des Américains identifiés comme blancs. « La carte indienne » révèle de réels avantages qui peuvent découler de l’appartenance à une tribu, mais la richesse instantanée n’en fait pas partie. Et la quête d’appartenance peut être douloureuse.
Les calculs du « quantum de sang » sont encore courants parmi de nombreuses tribus, mais la formule a été truquée dès le départ contre les Amérindiens. Contrairement aux notions racistes et farfelues telles que la prétendue règle de la « goutte unique » qui déterminait qui pouvait être réduit en esclavage ou qui serait soumis à l’apartheid de Jim Crow, lorsqu’il s’agissait de déterminer qui était qualifié d’Amérindien, le gouvernement suprémaciste blanc se considérait comme l’arbitre de qui. n’était pas Native basée sur certains pourcentages d’ascendance blanche. Le gouvernement voulait diminuer le nombre d’Amérindiens et remplacer l’identité tribale par la blancheur.
Depuis plus de 500 ans, les Amérindiens et les individus d’Europe et d’Afrique brouillent et redessinent les frontières entre leurs peuples, et au cours de ces siècles, des millions d’individus ont eu des millions de raisons de s’identifier à un ou plusieurs aspects de leur ascendance. Avant le recensement de 2000, cette complexité était officiellement invisible, car chaque habitant ne pouvait déclarer qu’une seule race.
Depuis 200 ans, le gouvernement fédéral a utilisé la reconnaissance officielle comme une arme et un coin ; Pendant tout ce temps, de nombreuses tribus elles-mêmes ont tenté de se conformer à de vieilles notions eurocentriques de race, longtemps discréditées, avec des résultats tragiques.
Alors bien sûr, Schuettpelz ne peut pas offrir une explication simple à l’énigme du début du livre sur ce qui a changé entre 2000 et 2020. En ce qui concerne l’identité amérindienne, le changement a été la seule constante. Seuls les 7,8 millions d’individus eux-mêmes ont pu expliquer pourquoi ils se sont identifiés comme autochtones en 2020 mais n’étaient pas officiellement membres d’une tribu reconnue.
Les grandes questions qui ont poussé Carrie Lowry Schuettpelz à examiner les données, à rechercher des histoires individuelles et collectives, ne trouvent que partiellement réponse. L’explication la plus satisfaisante réside peut-être dans le microcosme qu’elle partage généreusement avec les lecteurs : dévoilant les façons dont elle se connaît sous le nom de Lumbee, elle établit la manière dont ses enfants connaîtront et seront connus par sa communauté.
Lorraine Berry est une écrivaine et critique vivant dans l’Oregon.





