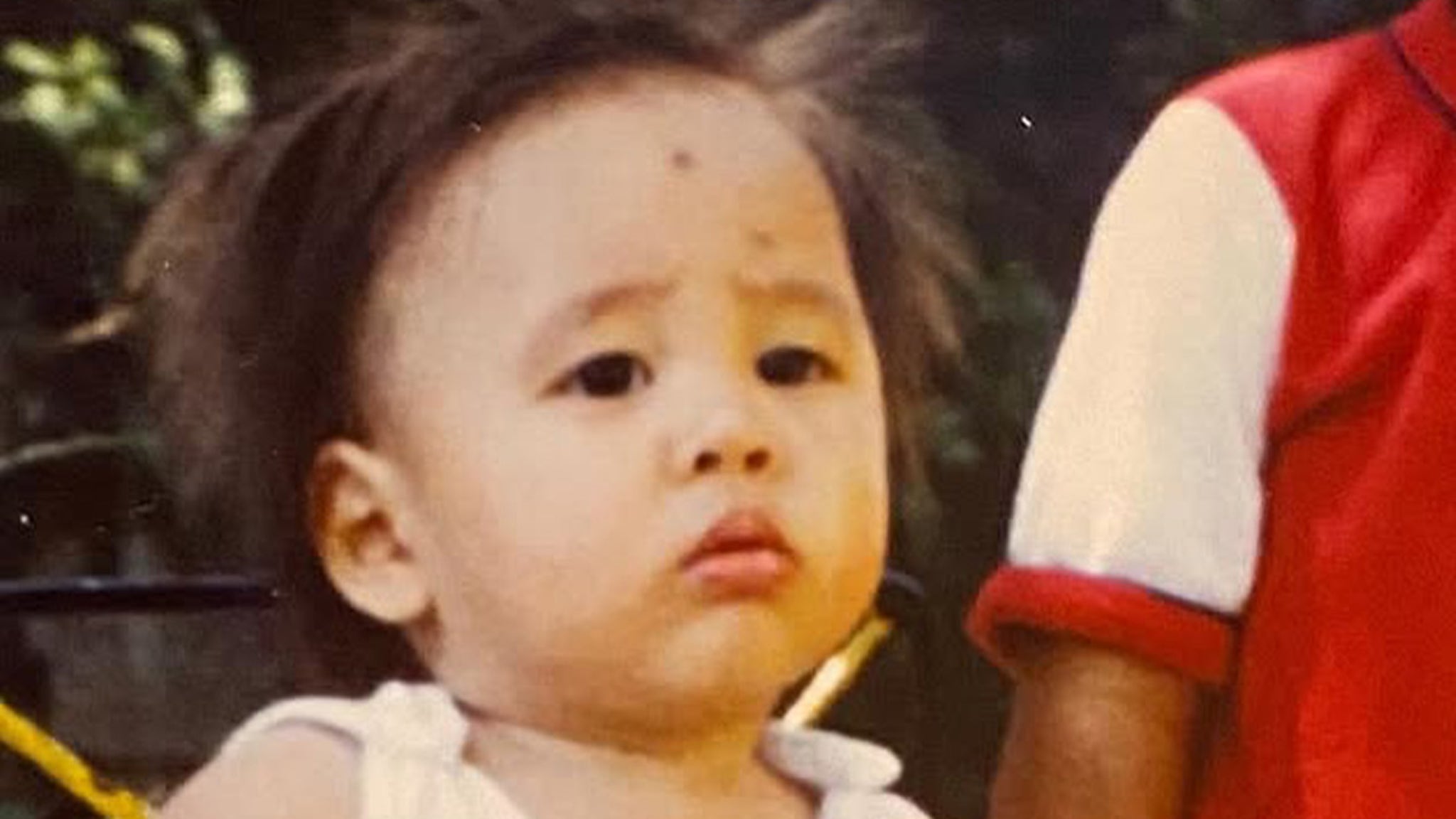Donald Trump n’a guère été un défenseur d’une gouvernance mondiale responsable au cours de son premier mandat. Son retrait des accords multilatéraux, notamment l’accord sur le nucléaire iranien et les accords de Paris sur le climat, témoigne d’un mépris inhabituel pour les institutions et la coopération internationales. Il n’a guère de respect évident pour « l’ordre international fondé sur des règles » favorisé par l’administration Biden. Mais c’est là une opportunité.
L’idée selon laquelle les États-Unis maintiennent la stabilité mondiale en dirigeant un ordre « fondé sur des règles » tend à susciter plus de mauvaise volonté que de bonne volonté dans de nombreuses régions du monde. Plutôt que d’offrir une vision américaine positive, il en est venu à symboliser l’hypocrisie américaine et les deux poids, deux mesures. Trump ferait bien de supprimer cette expression du lexique américain.
Le concept d’un ordre fondé sur des règles a gagné en popularité au sein de l’establishment de la politique étrangère de Washington DC, connu sous le nom de « blob », ces dernières années, car il résume la façon dont les experts – libéraux et néoconservateurs, dont beaucoup ont été aveuglés par Trump et chassés du pouvoir – considéraient ce qui se passait. eux et l’Amérique représentaient.
L’administration Biden a fait de la formulation fondée sur des règles un principe organisateur de sa politique étrangère. Cette idée a joué un rôle clé dans le renforcement des États partageant les mêmes idées pour contrer la Chine et la Russie, que Washington accuse de chercher à renverser l’ordre mondial actuel. Pourtant, les erreurs de cet ordre ont été mises à nu par la militarisation par Washington de ce concept contre ses ennemis géopolitiques, alors même que, par exemple, les États-Unis fournissent des armes à Israël malgré leurs efforts répétés. violations de droit international.
Plus important encore, le concept fondé sur des règles a masqué ses propres motivations révisionnistes. L’objectif de maintenir la domination américaine sur le système international a empêché l’établissement d’un cadre juridique mondial fonctionnel. Cela risque d’inciter à la formation de nombreux ordres concurrents plutôt qu’à un système plus collaboratif suivant un ensemble de lois unique.
La Chine a inculpé discours basé sur des règles pour masquer la domination d’une seule puissance sur le globe. Jusqu’à présent, sa réponse a toutefois été d’opérer dans le cadre du système existant tout en cherchant à le réformer à sa guise. Mais si Biden avait réussi à transformer l’ordre international fondé sur des règles en un bloc, la Chine aurait pu réagir en s’associant à la Russie et aux États du Sud pour former un bloc rival doté de ses propres lois.
Bien que les pays du Sud aient des désaccords avec la Russie et la Chine, beaucoup sont unis dans leur opposition à la vanité fondée sur des règles, qu’ils considèrent comme largement conçue pour prolonger l’unipolarité américaine au détriment des puissances émergentes telles que le Brésil et l’Inde. « Je suis frappé de voir à quel point nous avons perdu la confiance des pays du Sud », a admis le président français Emmanuel Macron lors de l’édition 2023. Conférence de Munich sur la sécurité.
Un monde dans lequel les États ne diffèrent plus sur des interprétations concurrentes d’un régime juridique mais proposent plutôt des ensembles de règles concurrentes est plus effrayant que tout ce que Trump a fait jusqu’à présent.
Plus l’Amérique et ses alliés brisent l’ordre juridique mondial au nom de leurs règles, moins personne ne les respecte. Nous ne pouvons pas forger un ordre international en imposant des règles à des États qui ont été exclus de leur formulation. Il n’est pas étonnant que de nombreux experts en droit international considèrent le concept d’ordre fondé sur des règles. pas aussi complémentaire du droit internationalmais comme une menace pour lui.
Un monde multi-ordres dépourvu d’un cadre de travail pour l’engagement, la collaboration et la désescalade alimenterait les conflits et la concurrence entre les grandes puissances à un moment fragile. Elle serait moins capable de contenir une agression militaire, d’empêcher la prolifération nucléaire ou de gérer des crises communes telles que le changement climatique. Si la concurrence entre grandes puissances existe déjà, la question clé est de savoir si elle se déroule dans un cadre commun ou si elle devient l’affaire de chaque grande puissance pour elle-même.
Cela rend les choix de Trump essentiels. Il semble ouvert à un monde multipolaire, même si son investissement dans les règles et les lois est une autre affaire. Mais s’il veut vraiment réduire l’empreinte militaire mondiale de l’Amérique, rapatrier nos troupes et cesser de jouer le rôle de plus en plus indésirable de police mondiale, alors éviter l’anarchie et promouvoir la paix en maintenant un système multilatéral servira les intérêts américains et donc ceux de Trump.
Trump est un ardent défenseur de ses propres intérêts. Sa politique étrangère au cours de son premier mandat a été marquée par un transactionnalisme qui lui a parfois permis de transcender la moralisation typique de Washington en faveur de la promotion des intérêts américains par l’engagement, comme la négociation du retrait d’Afghanistan avec les talibans. Cette approche des affaires mondiales fondée sur le « qu’est-ce que cela m’apporte » pourrait permettre à Trump d’abandonner les mythes de Washington sur son ordre international de coalition de volontaires.
Un ordre mondial fonctionnel est une condition importante pour les objectifs apparents de politique étrangère de Trump, notamment remporter la compétition économique avec la Chine et forger la paix en Ukraine. Ces objectifs ne peuvent être atteints sans un cadre de sécurité sain et prévisible qui empêche les désaccords et les conflits de dégénérer en guerres mutuellement destructrices.
Certaines normes, lois et institutions existantes encouragent toute une série de bons résultats et méritent de rester en vigueur, notamment les règles de la Charte des Nations Unies qui limitent la force et les Nations Unies elles-mêmes. Quant à la fin des guerres en cours en Ukraine et à Gaza, cela dépendra de l’art de l’accord. Mais tout dépend si les négociations se déroulent dans l’ombre d’une certaine conviction selon laquelle il vaut mieux avoir des normes justes et communes.
L’ordre international fondé sur des règles a trahi cette possibilité. Au cours des quatre prochaines années, l’Amérique devra faire mieux.
Samuel Moyn est professeur de droit et d’histoire à Yale. Trita Parsi dirige le Projet Meilleure Commande au Quincy Institute, réunissant 130 universitaires et fonctionnaires de 40 pays pour développer des réformes du système multilatéral.