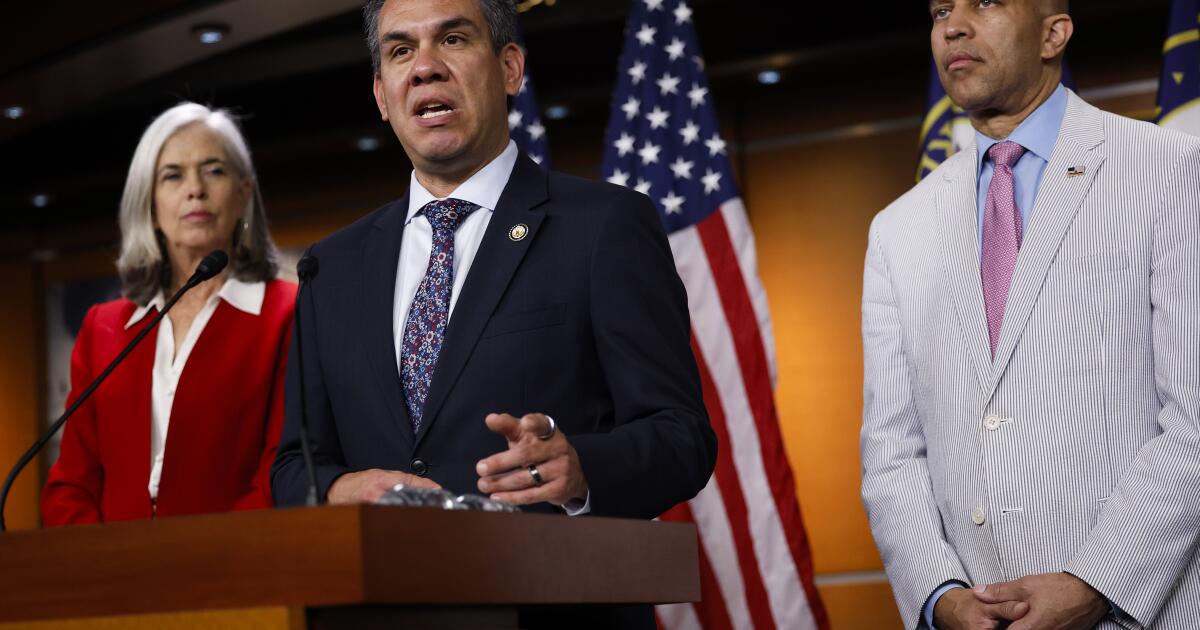Il est aisé de parler de référendum, de multiplier les communiqués de presse, ou les tweets… de parler d’etlections « libres », mais lorsqu’il s’agit de sécuriser la population, en particulier les personnes âgées, l’Etat haïtien se révèle inutile. Après le sanglant massacre de Cité Soleil, Fils-Aimé ou Voltaire alignera-t-il le corps diplomatique pour recevoir les vœux du Nouvel An ?
La fin de semaine du 6 au 8 décembre 2024, Haïti a sombré un peu plus dans I’indicible. Quelque 180 personnes ont été sauvagement massacrées, leurs corps incinérés ou jetés à la mer, dans un gigantesque acte de barbarie orchestré par des gangs. Au cœur de Cité-Soleil, un quartier déjà asphyxié par des décennies de marginalisation, cette tuerie dépasse la simple tragédie : elle représente une faillite totale de l’État, une abdication de ses responsabilités fondamentales. Alors que le génocide se déroulait, le gouvernement et les forces de sécurité étaient étrangement absents, abandonnant la population à son sort.
Le Premier ministre de facto, Alex Didier-Fils-Aimé, et Leslie Voltaire, le président « popetwel » du Conseil Presidentiel de la Transition, ont brillé par leur silence jusqu’a lundi matin. Leur silence face à cette tragédie pose la question suivante : peut-on encore parler d’un gouvernement lorsqu’il ne protège pas systématiquement ses citoyens ? Cette inaction remet en cause la nature même de la légitimité de ces autorités qui se préoccupent davantage de leur survie politique que du sort d’une population en danger.
Parallèlement, la mission kenyane, venue en Haïti sous mandat international, annonçait triomphalement la « récupération » d’un poste de police abandonné depuis plus d’un an à Petite-Rivière de l’Artibonite. Mais cette annonce relayée avec emphase apparaît dérisoire face à l’ampleur de la tragédie humaine en cours. Ce contraste tragique montre un décalage inquiétant entre les priorités des forces internationales et les urgences locales. Peut-on se réjouir d’un bâtiment vide alors qu’un massacre se déroule à quelques kilomètres de là ?
La normalisation de l’horreur a marqué l’histoire du pays. Ce massacre, aussi effroyable soit-il, risque de s’ajouter à une longue liste d’atrocités passées sous silence par les dirigeants locaux et la communauté internationale. Le silence et la passivité des autorités rappellent que, pour une partie de l’élite haïtienne, les enjeux diplomatiques de fin d’année – avec leurs vœux et photos officielles – sont plus importants que la vie de leurs concitoyens.
Cette tragédie relance une question primordiale : à partir de quand l’inaction devient-elle une complicité ? Le mutisme des autorités, la lenteur des réactions internationales, voire l’indifférence d’une partie de l’opinion publique, brossent un tableau peu reluisant. Les carences sécuritaires de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et l’absence de stratégie cohérente renforcent l’emprise des gangs, qui se présentent aujourd’hui comme les seuls maîtres des lieux.
Au-delà du choc et de l’indignation, ce massacre appelle une réflexion profonde sur la refonte des institutions haïtiennes. Peut-on continuer à supporter un système où l’État abdique face aux enjeux sécuritaires ? La responsabilité incombe également à la communauté internationale, dont l’intervention symbolique ne correspond pas aux réalités locales.
En cette fin d’année 2024, alors que certains s’apprêtent à échanger des vœux diplomatiques, il est bon de rappeler que des centaines de vies ont été fauchées dans l’indifférence générale. Pour ces victimes, pour leur mémoire, le peuple haïtien et ses alliés se doivent d’exiger une réponse non pas cosmétique, mais bien structurelle. L’heure n’est pas aux cérémonies, mais à l’action décisive.