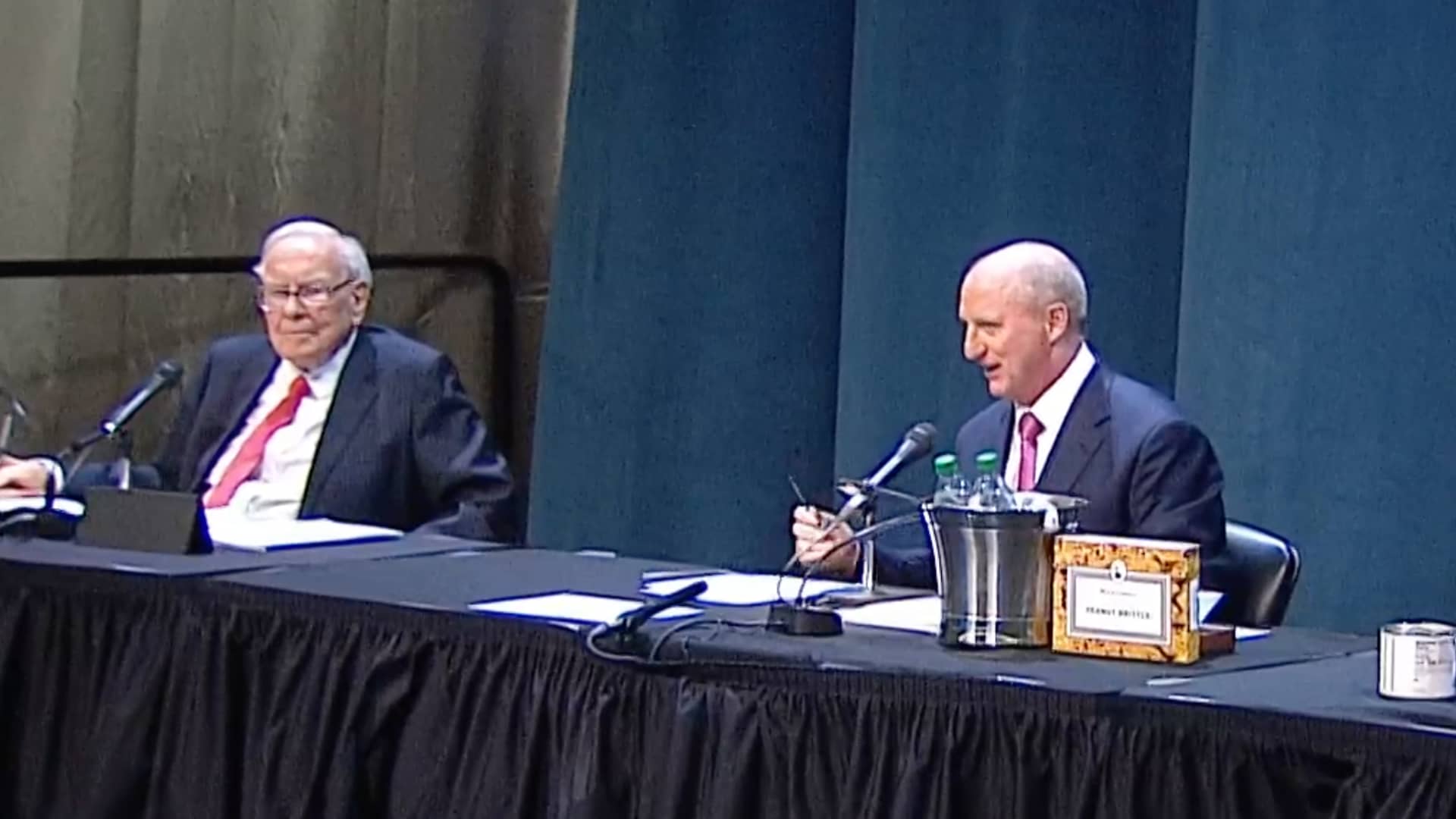L’Université de Harvard a récemment fait la une des journaux parce que le nombre d’étudiants noirs a diminué suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a déterminé que le programme d’action positive de Harvard devait prendre fin.
Harvard a également fait l’actualité en annonçant son retour aux tests standardisés. Plus récemment : certains professeurs protestataires de Harvard se sont vu refuser les privilèges d’une bibliothèque. Et quel sera l’effet sur Harvard de la politique du président élu Donald Trump ?
Si quelqu’un d’un autre pays fondait son point de vue sur l’enseignement supérieur américain uniquement sur les principaux reportages d’actualité, il pourrait conclure que les seules écoles qui existent sont les institutions de l’Ivy League et quelques valeurs aberrantes telles que Stanford, Duke et le Massachusetts Institute of Technology. En bref, l’équivalent académique du riche un pour cent aux États-Unis.
Pourquoi chaque fois qu’un journaliste veut prendre le pouls du système d’enseignement supérieur du pays, se tourne-t-il vers Harvard ? Diversité, étudiants en difficulté, courants politiques ou apathie : comment cela se passe-t-il à Harvard ? Et si un média a besoin d’interviewer un expert dans n’importe quel domaine, de la science politique à la littérature, la liste restreinte s’arrête à l’Ivy League. Alors qu’en réalité, de nombreux experts éminents et dignes d’intérêt travaillent ailleurs.
J’enseigne à la Montclair State University, une grande école publique dont les inscriptions s’élèvent désormais à plus de 24 000 personnes. Beaucoup de nos étudiants sont les premiers de leur famille à fréquenter l’université. Ils occupent souvent un ou plusieurs emplois pour s’en sortir. Lorsque nos étudiants obtiennent leur diplôme, ils ont acquis des compétences utiles et réussiront nettement mieux que sans ce diplôme.
Ce qu’ils ont accompli est, à certains égards, plus remarquable que le travail d’un autre diplômé de l’Ivy League qui s’est lancé dans la haute finance. Nous lisons beaucoup sur les tentatives des écoles des classes supérieures d’admettre ceux qui appartiennent aux rangs sous-représentés, mais ils ne lisent pas beaucoup sur les nôtres.
Je n’ai rien à redire en soi à ce qui est présenté comme des écoles d’élite, c’est-à-dire celles avec un taux d’acceptation extrêmement bas et des installations de recherche de premier ordre. Je comprends également que les legs de plusieurs millions de dollars iront à ces endroits plutôt qu’à notre école. Après tout, nous recevons un financement de l’État, mais lorsqu’une école comme Princeton dispose d’une dotation égale à celle d’un petit pays, cela donne à réfléchir.
Une telle position exaltée rend également une école inconsciente de ce qui se trouve au-delà des portes légendaires, quel que soit le nombre de bourses accordées par ces écoles.
Bien sûr, la publicité autour des écoles d’élite fait partie d’un problème plus vaste, tout comme les gens préfèrent lire sur les célébrités plutôt que sur celles qui ne le sont pas. La richesse et le pouvoir ont tendance à monopoliser le devant de la scène et à évincer les acteurs de soutien. Le public adhère à cette image. Le comportement des familles qui pleurent lorsqu’un de leurs enfants n’est pas admis à Harvard est particulièrement agaçant, même si l’on peut obtenir une excellente éducation dans de nombreux autres collèges.
Mais vous ne le sauriez pas d’après ce qui se passe dans l’actualité.
David Galef est professeur d’anglais et directeur du programme d’écriture créative à la Montclair State University dans le New Jersey/Tribune News Service