Critique de livre
La revanche du point de bascule : les histoires qui se propagent à grande échelle, les super-propagateurs et la montée de l’ingénierie sociale
Par Malcolm Gladwell
Little, Brown & Co., 368 pages, 32 $
Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission sur Librairie.orgdont les frais soutiennent les librairies indépendantes.
Il est juste de dire que « The Tipping Point » a marqué le tournant de la carrière de Malcolm Gladwell. En 2000, le livre a propulsé Gladwell, alors rédacteur du New Yorker, au rang de superstar littéraire. Il a également donné le coup d’envoi d’un nouveau genre de livres explicatifs en sciences sociales destinés au grand public.
Le concept de point de basculement – le moment où tout change soudainement et où un phénomène devient une épidémie – n’est pas une idée originale de Gladwell. Mais il l’a inscrit dans notre langage culturel. « Au moment où le livre de poche est sorti », écrit-il dans sa suite, « La revanche du point de basculement », « c’était dans l’air du temps ». Au fil des ans, Gladwell, qui est désormais également entrepreneur de podcasts, a produit d’autres best-sellers, parmi lesquels « Blink » (2005).“Les valeurs aberrantes (2008) et «« Parler aux étrangers » (2019). À sa synthèse habile de la recherche universitaire, il ajoute une curiosité journalistique, un style de prose vif et une maîtrise des juxtapositions contre-intuitives. Partant souvent d’une énigme, il recherche des études de cas et des concepts qui l’éclairent, modifiant (légèrement ou radicalement) notre compréhension du monde.
« La revanche du point de bascule » suit cette formule familière. Il est tentant de contester les analogies répétées de Gladwell entre les épidémies et les maladies sociales, et on peut se demander s’il ne sélectionne pas les exemples qui lui conviennent pour servir ses théories. Parfois aussi, le récit semble excessivement lent et discursif, car il passe, parfois brusquement, d’un sujet à l’autre. Néanmoins, la mise à jour de Gladwell de ses idées sur les points de bascule satisfera probablement les fans inconditionnels et défiera et divertira d’autres lecteurs.
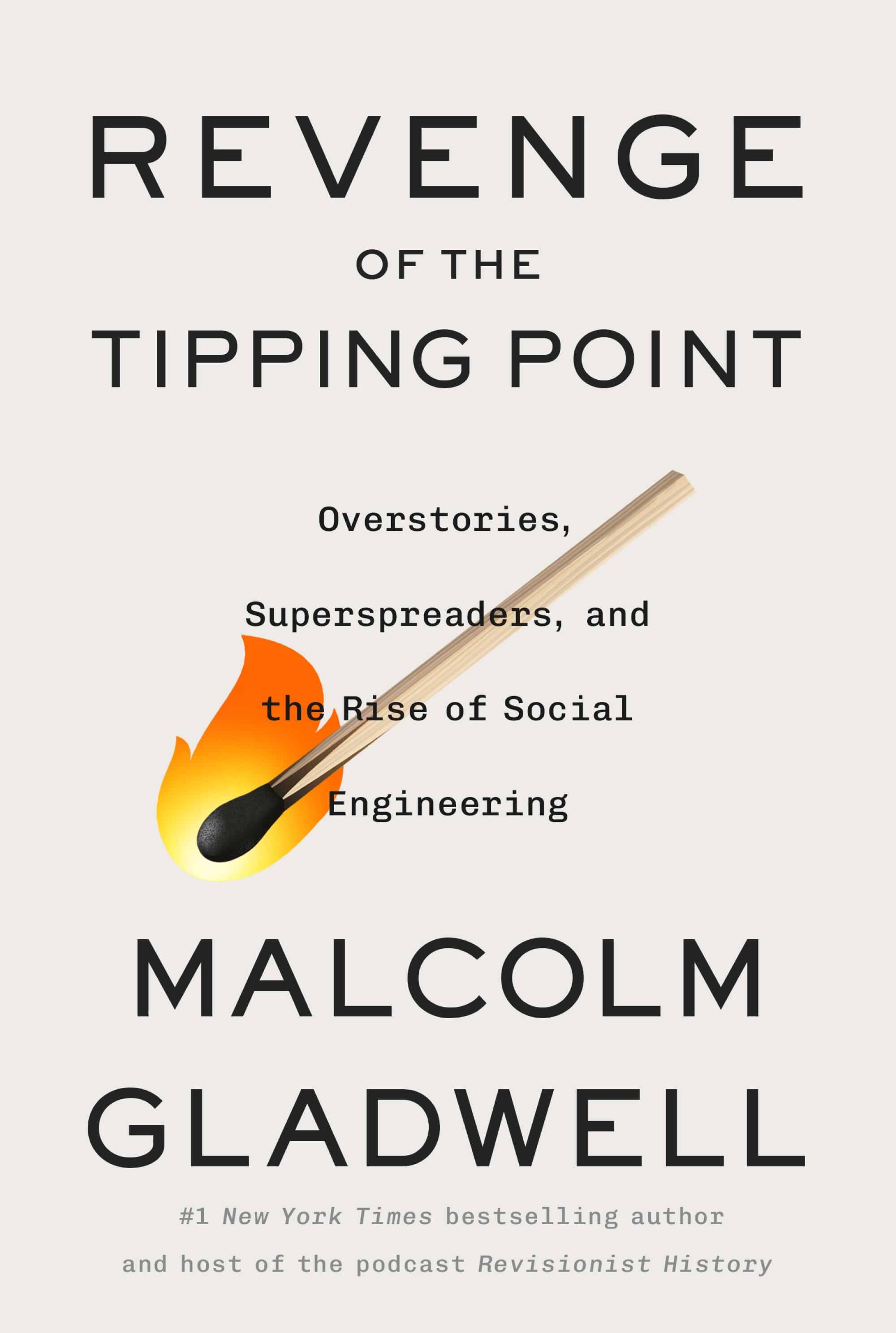
Couverture de « La revanche du point de bascule »
(Petit, Brun)
Le « point de bascule » original se concentrait sur trois concepts principaux qui, selon Gladwell, étaient essentiels à la compréhension des épidémies sociales. Il décrivait la loi du petit nombre, le rôle indispensable des messagers qu’il appelait « connecteurs », « experts » et « vendeurs » ; le facteur d’adhésion, impliquant la durabilité des messages ; et le pouvoir du contexte, c’est-à-dire le paysage plus large dans lequel les épidémies se déroulaient.
Avec « Revenge of the Tipping Point », il propose « un nouvel ensemble de théories, d’histoires et d’arguments sur les étranges chemins que suivent les idées et les comportements à travers notre monde ». Le titre fait référence à l’idée que les outils utilisés pour maîtriser les épidémies sociales à bon escient peuvent également avoir des effets délétères.
Le livre commence par une étude de cas anonyme que de nombreux lecteurs reconnaîtront immédiatement : il s’agit d’une audience au Congrès impliquant une entreprise accusée d’avoir fomenté une épidémie, et les témoins de l’entreprise répugnent à accepter la moindre responsabilité.
Gladwell introduit ensuite des énigmes liées à des études de cas. Il commence par une épidémie de braquages de banques qui a touché Los Angeles mais pas le pays entier, un exemple de « variation à petite échelle ». Une telle variation, soutient-il, est le produit de ce qu’il appelle l’histoire générale d’une communauté, un ensemble de déterminants culturels et sociaux. Pour le lecteur averti de Gladwell, cela semble être une autre approche du pouvoir du contexte.
En approfondissant le sujet, Gladwell visite une communauté très étudiée et obsédée par la réussite, connue dans la littérature en sciences sociales sous le nom de Poplar Grove. Dans un tic classique de Gladwell, il entremêle une histoire apparemment sans rapport, celle de l’uniformité génétique et de la vulnérabilité des guépards. Il soutient que ces deux populations – la ville et les guépards – sont toutes deux des monocultures et manquent donc de résilience. Ce manque, ainsi qu’un environnement à haute pression, contribuent à expliquer l’épidémie de suicides à Poplar Grove, suggère-t-il.
La section suivante du livre traite de l’ingénierie sociale et de la règle du « tiers magique », incarnée par la fuite des blancs des quartiers urbains. Les points de basculement, écrit Gladwell, « peuvent être conçu délibérément.« Un exemple, à Palo Alto : le Lawrence Tract, une communauté planifiée où les Blancs, les Noirs et les Asiatiques se sont engagés à vivre ensemble en nombre égal pour tenter d’éviter un point de basculement racial, quel qu’en soit le coût individuel.
Une autre étude de cas, particulièrement pertinente après la décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière, qui a annulé la discrimination positive fondée sur la race dans les admissions à l’université, concerne l’existence d’une équipe de rugby féminin à Harvard. Pourquoi Harvard (un défendeur dans le procès de discrimination positive) a-t-elle besoin d’une telle équipe, se demande Gladwell, et, plus généralement, pourquoi tant d’athlètes médiocres sur le plan académique sont-ils acceptés à l’université ?
En fustigeant William Fitzsimmons, le doyen des admissions de Harvard depuis de nombreuses années, Gladwell est particulièrement sarcastique. Fitzsimmons affirme notamment que « le fait d’avoir une tradition sportive dynamique… fait une grande différence dans notre capacité à attirer tous les types d’étudiants ». Mais Harvard n’admet actuellement que 3,4 % de ses candidats, note Gladwell, et « qui est cette personne imaginaire… qui refuserait une offre de Harvard parce que la scène sportive n’est pas suffisamment « dynamique » ? »
En fait, explique Gladwell de manière convaincante, Harvard utilise le sport pour maintenir sa proportion d’étudiants « blancs » « préparés… sur les terrains de jeu des country clubs des États-Unis ». Son analyse ne permet pas de déterminer avec certitude si la blancheur ou la richesse de ces étudiants est le facteur déterminant dans les calculs de Harvard, ni comment cette prédilection interagit avec les efforts de Harvard pour diversifier sa population étudiante. Mais, selon Gladwell, « la mauvaise action affirmative a été portée devant le tribunal ».
Gladwell aborde également en détail la notion de super-propagateur, familière depuis la pandémie de COVID-19 et illustrée par la réunion de février 2020 de la société de biotechnologie Biogen à Boston. On y trouve une longue discussion sur la transmission par aérosol, la salive et la déshydratation – et, en fin de compte, ce qui semble être une variante de la vieille idée du messager à la puissance déséquilibrée.
Nous passons ensuite à ce que Gladwell appelle les histoires de l’esprit du temps, une manière de conceptualiser le changement culturel. Il cite le rôle de la mini-série télévisée « Holocauste » de 1978 dans la transformation des politiques de la mémoire, et de la comédie « Will & Grace », diffusée pour la première fois en 1998, dans la révolution des idées sur les homosexuels et les relations amoureuses. « Les histoires de l’esprit du temps », écrit Gladwell, « sont bien plus volatiles qu’il n’y paraît. »
Dans le dernier volet, Gladwell applique astucieusement ces concepts à son étude de cas démystifiée, qui semble chevaucher le fossé entre les épidémies sociales et biologiques.
Il n’est pas nécessaire d’acheter tout ce que Gladwell vend pour apprécier « Revenge of the Tipping Point ».« Il s’avère qu’essayer de mettre en évidence des failles dans ses arguments constitue au moins la moitié du plaisir.
Julia M. Klein est journaliste et critique culturelle à Philadelphie.





