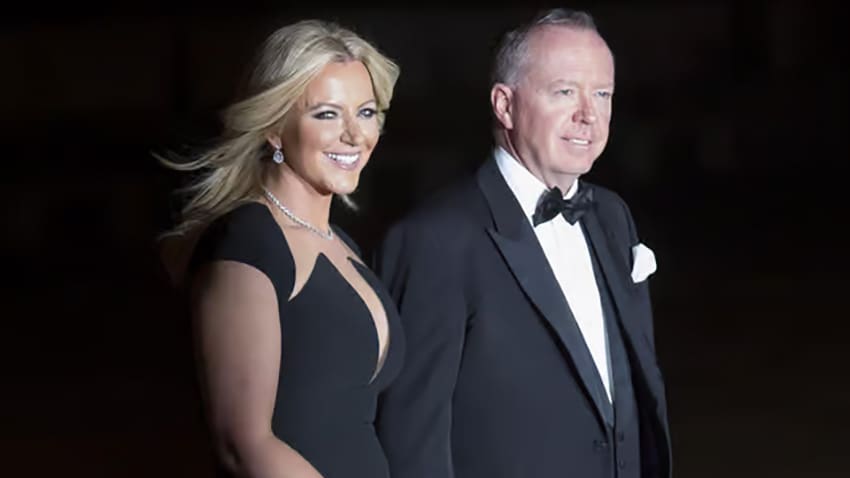Les responsables britanniques ont commencé à classer les documents commerciaux sensibles comme «secrètes» et «top secrètes» dans le but de protéger les informations clés des homologues américains, car les relations entre Londres et Washington Strain sous la guerre tarifaire du président Trump, ont appris les affaires commerciales.
Cette décision marque un changement important dans les protocoles du gouvernement interne, soulignant les préoccupations concernant l’utilisation ou l’interception potentielle des données économiques britanniques lors des discussions commerciales en cours avec les États-Unis. Des sources ont confirmé que des directives mises à jour ont été émises dans les départements impliqués dans la négociation des relations commerciales post-Brexit du Royaume-Uni, avec des règles plus strictes sur le partage numérique et l’accès aux documents, concernant en particulier les secteurs sensibles tels que l’automobile et les produits pharmaceutiques.
Le changement intervient alors que la Maison Blanche de Trump continue de tracer les marchés mondiaux avec des tarifs radicaux sur les partenaires commerciaux. Le Royaume-Uni a été touché avec 10% de tarifs sur toutes les exportations vers les États-Unis et un Taux punitif de 25% sur les voitures et l’acier, provoquant un malaise croissant à Whitehall.
Dans un écart marqué de la transparence observée lors des négociations avec l’administration Biden, le département britannique pour les affaires et le commerce a élevé la classification de nombreux documents. Auparavant étiqueté comme «officiel – sensible (yeux britanniques uniquement)», beaucoup sont désormais soumis à des restrictions généralement réservées aux documents de sécurité de haut niveau.
Une source principale proche de la question a déclaré: “La reclassification ne consiste pas à rompre les liens avec les États-Unis, mais reflète la volatilité et l’imprévisibilité accrue de la politique américaine actuelle sous Trump. Les industries exposées aux tarifs de représailles, les ministres et les fonctionnaires sont prudents quant à qui voit quoi.”
Malgré cela, Downing Street a évité la confrontation directe. Le Premier ministre Keir Starmer a refusé de riposter contre les actions commerciales de Trump, offrant plutôt des concessions dans des domaines tels que la fiscalité numérique et les normes agricoles, tout en continuant à hiérarchiser un accord commercial à long terme avec les États-Unis.
Dans le but de lisser les tensions, Le vice-président américain, JD Vance, a déclaré mardi qu’un «grand accord» était toujours possibleet a salué l’alignement culturel entre les deux pays. “Nous travaillons certainement très dur avec le gouvernement de Keir Starmer”, a déclaré Vance. «Il y a une véritable affinité culturelle.»
Pourtant, dans les coulisses, de nombreux décideurs et chefs d’entreprise britanniques sont préoccupés par les implications plus larges de la stratégie «America First» de Trump. La reclassification des documents commerciaux fait partie d’un resserrement plus large de la sécurité, avec de grandes multinationales au Royaume-Uni – en particulier les entreprises pharmaceutiques – qui ont conseillé d’adopter des protocoles de communication plus stricts lorsqu’ils interagissent avec les services gouvernementaux.
Les développements reflètent une appréhension internationale plus large. Les rapports de Bruxelles suggèrent que la Commission européenne a commencé à émettre des téléphones de brûleur au personnel visitant les États-Unis et repense ses politiques de gestion des documents pour éviter la surveillance américaine.
Alors que le Royaume-Uni et les États-Unis ont traditionnellement apprécié les liens étroits – en particulier dans la défense et l’intelligence, où le matériel partagé est souvent marqué «UK / US uniquement» ou classé sous l’alliance «Five Eyes» – la politique de la trame semble désormais divergente de cette intimité.
La stratégie tarifaire agressive de Trump est considérée comme une tentative de réindustrialisation des secteurs clés de l’économie américaine, y compris la fabrication automobile et pharmaceutique, souvent au détriment des alliés de longue date. Il a défendu les mouvements, reconnaissant les «coûts de transition» mais insistant sur le fait qu’ils sont nécessaires au renouvellement national.
Pendant ce temps, les retombées se poursuivent. Les tarifs américains sur les produits chinois ont grimpé à 145%, ce qui a provoqué des tarifs de représailles de Pékin jusqu’à 125%. La Chine a averti qu’elle pourrait recourir à des contre-mesures alternatives et a exhorté l’UE à résister à ce qu’il a décrit comme «l’intimidation» de Trump.
Alors que Trump a récemment accepté de retarder d’autres tarifs sur certaines nations pendant 90 jours, le Royaume-Uni continue de faire face à des tâches sur les exportations de base. L’incertitude contribue également à l’instabilité sur les marchés financiers mondiaux, ce qui a suscité des questions sur la viabilité à long terme des alliances traditionnelles dans un environnement commercial changeant.
Alors que le gouvernement de Starmer marche sur la corde raide entre la diplomatie et l’intérêt national, la reclassification de la documentation commerciale marque une nouvelle ère dans le traitement des négociations sensibles par la Grande-Bretagne – et signale que la confiance, même parmi les alliés, n’est plus supposée.
Jamie Young
Jamie est journaliste principal chez Business Matters, apportant plus d’une décennie d’expérience dans les rapports commerciaux des PME britanniques. Jamie est titulaire d’un diplôme en administration des affaires et participe régulièrement aux conférences et ateliers de l’industrie. Lorsqu’il ne fait pas rapport sur les derniers développements commerciaux, Jamie est passionné par le mentorat de journalistes et d’entrepreneurs émergents pour inspirer la prochaine génération de chefs d’entreprise.