Critique de livre
99 % de transpiration : une nouvelle histoire de travail du mode de vie américain
Par Adam Chandler
Panthéon : 284 pages, 28 $
Si tu acheter des livres liés sur notre siteLe Times peut gagner une commission de Bookshop.org, dont les frais soutiennent les librairies indépendantes.
Les faits et les chiffres illustrent largement l’obsession de longue date de l’Amérique pour les vertus du travail acharné, et « 99 % de transpiration », le mélange malicieux de récit de voyage et d’analyse sociale d’Adam Chandler, contient beaucoup des deux. Par exemple : un sondage sur les opportunités économiques réalisé en 2023 par Gallup a révélé que 39 % des Américains pensaient qu’ils ne parvenaient pas à progresser malgré leur travail acharné. Et : selon les données du recensement, plus de 10 % des Américains non âgés (27,4 millions) ont vécu en 2020 sans assurance maladie (contre 0,0 % dans tous les autres pays industrialisés).
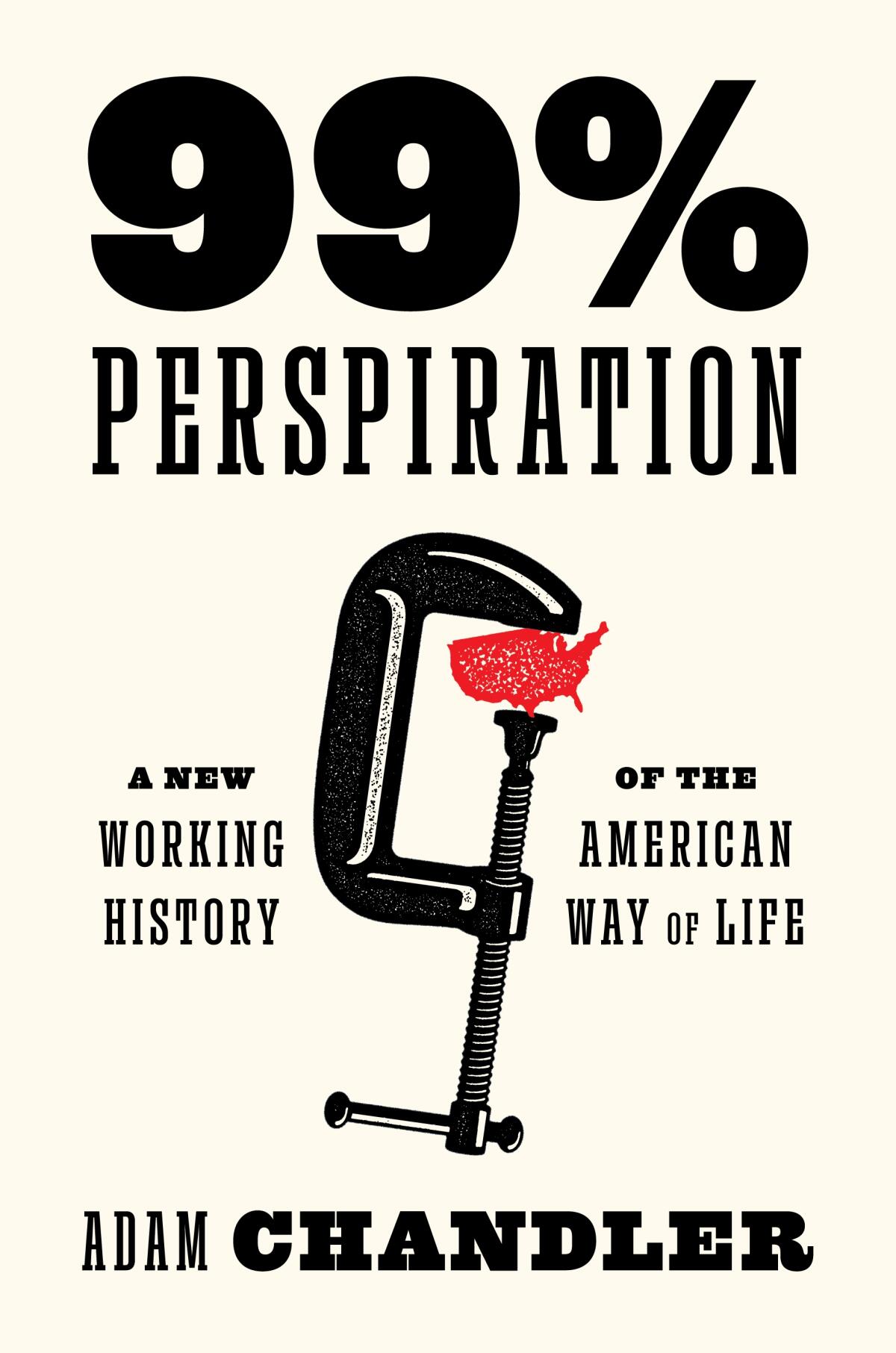
Les chiffres ne sont pas gentils, mais ils ne constituent pas l’essentiel du livre de Chandler. C’est une bonne chose, que vous souscriviez ou non à la vieille maxime sur les « mensonges, foutus mensonges et statistiques » (attribuée par Mark Twain au Premier ministre britannique Benjamin Disraeli). Il s’agit d’un livre très humain sur les racines et les conséquences d’un dilemme très américain : la conviction que l’huile de coude à l’ancienne vous mènera là où vous voulez aller.
« 99 % de transpiration », qui tire son titre d’une citation attribuée à Thomas Edison – « Le génie, c’est 1 % d’inspiration et 99 % de transpiration » – est plus qu’un simple diagnostic. Il s’agit également d’une étude approfondie sur comment et pourquoi les mythes nationaux se propagent et d’un compte rendu de terrain de la façon dont nous vivons et travaillons aujourd’hui. C’est, comme on dit, une bonne lecture, extraite de réalités troublantes.

Adam Chandler, auteur de « 99 % de transpiration ».
(Katie Basile)
Chandler, ancien rédacteur à l’Atlantic et auteur de « Drive-Thru Dreams : A Journey Through the Heart of America’s Fast-Food Kingdom », s’aventure dans le passé et le présent, le réel et le fictif, cherchant à comprendre pourquoi nous consacrons tellement de temps et d’énergie au travail, aux dépens de tout le reste, et avec des dividendes de plus en plus faibles. Il se penche sur les origines du pays et sur la façon dont des penseurs américains fondateurs comme Benjamin Franklin considéraient le travail acharné comme un trait commun au sein d’un ensemble de colonies qui n’avaient pas grand-chose d’autre en commun. Comme l’écrit Chandler, « le style de vie américain obsédé par l’industrie et le cerf-volant dans l’orage était l’une des rares choses qui unissaient les différentes factions divisées de l’ensemble fondateur de l’Amérique. »
Il s’attaque à l’ironie cruelle d’une nation qui prêche les récompenses de l’équité en sueur, mais qui s’est construite en grande partie sur le travail punitif et déshumanisant des esclaves. Et il explore le flou et la sélectivité inhérents à la notion d’« exceptionnalisme américain », un concept qui nécessite de plus en plus de dissonance cognitive à mesure qu’il est analysé.
Il est juste de dire que Chandler fait des digressions et des détours, et vous pourriez parfois vous demander : où allons-nous ici ? Ensuite, il relie les points de manière ludique, pas toujours proprement, mais certainement avec verve et généralement avec bonne humeur.
Une escale en Oklahoma s’avère particulièrement fructueuse. Il rend d’abord visite à Arshad Lasi, qui, avec ses parents immigrés indiens, a créé l’entreprise de cannabis la plus prospère à Tulsa, une entreprise qui lui a appris plus sur le fonctionnement des affaires que ne l’a jamais fait une école de commerce. Il visite une communauté qui a été récompensée pour son courage par la mort et la destruction : Greenwood, le « Wall Street noir » de Tulsa, qui a été entièrement incendiée par des voisins blancs pleins de ressentiment lors du massacre racial de Tulsa en 1921. Puis il s’aventure à Pawhuska, où « une confédération de méchants » a trompé et assassiné la communauté Osage avec l’argent du pétrole, un scandale relaté dans le livre de David Grann « Killers of the Flower Moon » et son adaptation cinématographique de 2023.
Il est difficile de manquer la leçon ici. La mesure dans laquelle le travail acharné est récompensé dépend souvent de celui qui détient le pouvoir et les armes.
Il y a un élément de darwinisme social dans la philosophie du travail-travail-travail, une dureté de cœur que Chandler relie à l’eugéniste et président de longue date de l’Université de Stanford, Ray Lyman Wilbur. « Il est courant que chaque individu ait droit à la sécurité économique », a écrit Wilbur. « Les seuls animaux et oiseaux que je connaisse qui jouissent d’une sécurité économique sont ceux qui ont été domestiqués – et leur sécurité économique est contrôlée par la clôture en fil de fer barbelé, le couteau de boucher et le désir des autres. Ils sont traites, écorchés, pondus ou mangés par leurs protecteurs.
Et si la déshumanisation figurative ne suffit pas, il y a toujours la déshumanisation littérale. L’auteur s’amuse avec un chatbot dans un drive-in d’Hardee – pour Chandler, tout revient à la restauration rapide – en essayant de le surprendre avec une demande assez simple à laquelle il ne peut pas répondre. Lorsqu’un être humain prend le relais de la machine, Chandler semble non seulement heureux mais visiblement soulagé. “En fait, j’aime ça”, dit l’humaine, nommée Kristi, à propos du chatbot. “C’est très utile quand nous sommes en désavantage numérique.”
Il existe des alternatives à la corvée éternelle et, du point de vue américain, elles semblent carrément radicales. En 2016, le Parlement français a adopté une loi visant à donner aux salariés le droit de ne pas répondre aux communications liées au travail en dehors des heures de bureau. Cela s’ajoute à l’obligation légale de longue date de prendre une pause déjeuner. Oui, Chandler se rend à Paris, où il fait une tournée consacrée à la populaire série Netflix « Emily in Paris ». La série parle d’une Américaine dynamique qui apporte son esprit positif à la Ville Lumière, dont les habitants sont un peu rebutés par son manque de sang-froid. « On vit pour travailler », reproche Luc, un collègue. « On travaille pour vivre ! » Touché, Luc. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je dois vérifier mes e-mails.
Chris Vognar est un écrivain culturel indépendant.





