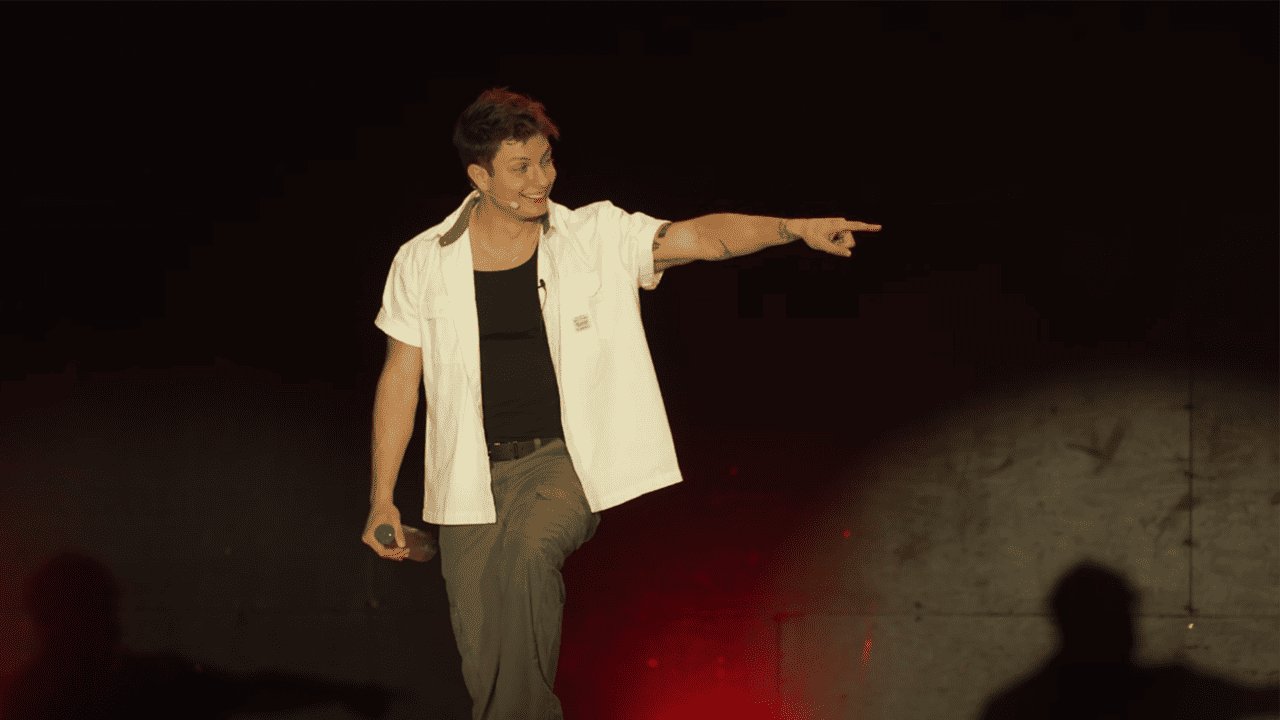Critique de livre
Cette terre sans mère
Par Nikki May
Livres Mariner : 352 pages, 30 $
Si vous achetez des livres liés sur notre site, le Times peut percevoir une commission de Librairie.orgdont les redevances soutiennent les librairies indépendantes.
Librement inspiré du roman le plus explicitement politique et controversé de Jane Austen, « Mansfield Park », « This Motherless Land » de Nikki May explore les conflits de coutumes et de classes dans une famille nigériane et anglaise controversée.
Organisé autour de quatre moments charnières de la vie de deux cousins – l’un né au Nigeria et métis, l’autre anglais et blanc – ce drame de May, qui a également écrit « Wahala », expose comment les liens familiaux se lient et se divisent. En 1978, Funke Oyenuga, 10 ans, mène une vie confortable dans la banlieue de Lagos avec sa mère anglaise éthérée et artistique, son père fier et intellectuel et son jeune frère agaçant, Femi. Leurs parents superstitieux et désapprobateurs, le talent de Femi pour dominer l’attention de la famille et le statut de Funke en tant que fille dans un endroit où les garçons sont favorisés sont ses plus grands ennuis. Puis soudain, un pétrolier brise son monde avec la force d’une tornade. En un clin d’œil, sa mère et son frère sont morts, son père est un désastre inutile et Funke est envoyée en Angleterre pour vivre avec la famille de sa mère, qu’elle n’a jamais connue.
Comme Fanny Price, à l’âge de 10 ans, Funke Oyenuga devient une enfant déplacée, à la merci de parents plus aisés, qui se considèrent simplement comme ses supérieurs. Contrairement à Fanny d’Austen, Funke est brune, et cela entraîne ses propres complications parmi les Stones aristocratiques et blanc lys du Somerset, qui portent une fierté déplacée dans une gloire passée depuis longtemps. Comme Funke s’en rend compte : « Elle avait été nourrie d’un tas de mensonges. L’Angleterre n’était pas un pays d’abondance de conte de fées et ces gens n’étaient pas riches. La maison était délabrée et usée : tapis troués, sols grinçants, meubles délabrés.

Il s’agit d’un éveil culturel brutal et, entre les mains habiles de May, incroyablement spécifique et bien observé. Dans la première partie du roman, qui se déroule lorsque Funke était jeune, tout ce qu’elle pensait savoir sur l’Angleterre s’avère faux et elle est traitée comme une citoyenne de seconde zone dans sa propre famille. Au milieu de circonstances décevantes, la meilleure partie de cette nouvelle vie est l’étreinte enthousiaste de sa cousine Olivia, ou Liv. Le lien qui unit les filles est instinctif et, du moins pour Liv, débridé. Le cousin grossier Dominic, le frère de Liv, est une autre histoire – il appelle Funke « Zebra ». Et leur mère, tante Margot, est raciste et irritée par les talents de Funke, qui rappellent la mère décédée de Funke.
Le racisme existe sur un large spectre dans ce nouveau pays étrange, et il est principalement traité comme un échec omniprésent mais personnel. Même Liv regarde Funke – que les Stones finissent par appeler par son deuxième prénom plus britannique et socialement acceptable, Kate – comme si elle était une créature exotique : « Kate était la première personne noire avec laquelle Liv s’est rapprochée. » Pour Liv, « le plus grand choc était à quel point elle était ordinaire. Secrètement, Liv avait espéré que son cousin serait à moitié sauvage. Elle avait évoqué une créature sauvage et féroce, noire de jais avec des perles dans les cheveux, lourde et forte, une lionne belle mais effrayante.
Pourtant, en temps voulu, bien qu’elle soit reléguée dans le grenier du domaine en ruine des Stones comme l’aide, tout le monde, sauf Dominic et Margot, se réconcilie avec le talentueux et travailleur Funke. Plus tard, à mesure que Funke s’acclimate, il devient de plus en plus clair que Liv et tous les Stones ont leurs propres croix à porter, dont la moindre n’est pas Margot constamment critique et sapante. Bien que leur éclat ait disparu depuis longtemps, le nom de la famille Stone est toujours illustre (le grand-père, Lord Stone, était autrefois ministre de l’Intérieur). Et ça, Margot, l’ambitieuse socialement, ne le lâchera jamais.
Force fascinante et malveillante dont les désirs inextinguibles empoisonnent tout autour d’elle, Margot pousse la rivalité fraternelle et l’anxiété de statut au bord de la folie. Margot est obsédée par la diminution de ses privilèges et par le courage qu’elle pense que sa sœur Lizzie, la mère de Funke, a volé il y a des années. Bien avant que l’accident catastrophique ne réunisse Liv et Funke, Lizzie était la star de la famille, celle qui avait soif de vie et l’esprit de défier les conventions, épousant un bel étudiant en médecine nigérian. Margot a toujours eu du ressentiment envers sa sœur dynamique, mais la rivalité s’est transformée en haine à long terme lorsque Lizzie s’est mariée en dehors des normes sociétales, diminuant ainsi les chances de Margot dans leurs cercles. Et Margot n’a jamais dépassé ce niveau.
À mesure que le temps passe aux années 1986, 1992 et 1998, des péchés et des ressentiments vieux de plusieurs décennies se révèlent de plus en plus toxiques. C’est Margot qui fait le plus de victimes chez Liv, qui a soif d’amour et d’acceptation qu’elle ne pourra jamais obtenir de sa mère : « Liv avait laissé tomber sa mère en étant trop grosse puis trop mince ; trop sauvage puis trop ennuyeux ; trop fort puis trop silencieux. Chaque semaine, sa mère choisissait un échec spécifique. Les luttes familiales dépassent les frontières de sœur à sœur et de mère à fille et deviennent intergénérationnelles. La relation entre Funke et Liv devient tout aussi compliquée et, finalement, dangereuse. Les conséquences de l’imprudence croissante de Liv et Dominic sont imputées à Funke, et pendant ce temps, Margot complote pour s’emparer de ce qui reste de la fortune Stone.
C’est dans cette dissection des conséquences des privilèges familiaux et des griefs personnels toxiques que le roman gagne du terrain. Le deuxième roman de Nikki May excelle dans la description des coupures et des cicatrices complexes causées par les conflits familiaux et l’obsession du statut au niveau interpersonnel. La race complique les choses, mais pas de manière particulièrement politique. « Cette terre sans mère » est au centre de l’intrigue successorale de « Mansfield Park », mais les luttes d’orgueil et les préjugés mesquins sont un autre motif explicite. Les jalousies qu’elles suscitent sont le véritable moteur de cette histoire mélodramatique mais satisfaisante.
Carole V. Bell est une écrivaine culturelle et une chercheuse en médias qui explore la politique et l’identité dans l’art.