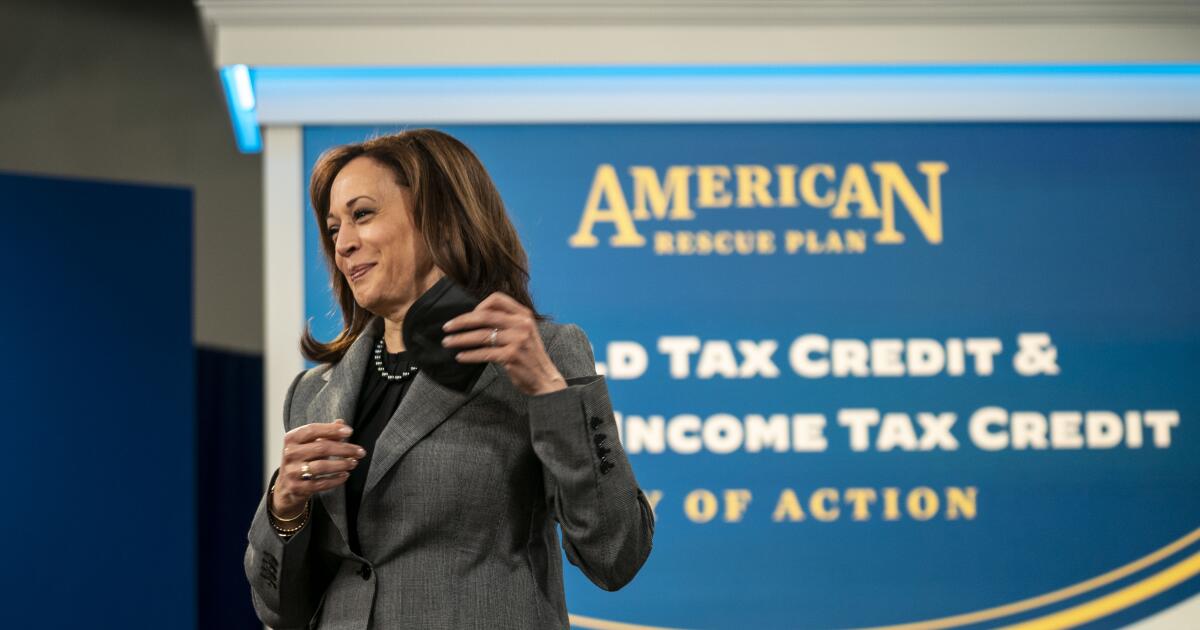par Nicole Theodore
Les récents massacres, destructions et atrocités perpétrés par des gangs armés en Haïti jettent une lumière crue sur une réalité insoutenable : la haine entre Haïtiens, alimentée par des décennies de divisions sociales, économiques et culturelles, est en train de consumer le pays. Cette haine dépasse les lignes de classes, les barrières géographiques et les niveaux d’éducation. Elle s’insinue dans tous les recoins de la société, rongeant les bases mêmes d’une nation qui, pourtant, s’est construite sur un idéal de liberté et d’unité.
Dans un passé pas si lointain, beaucoup expliquaient la montée des gangs par le désespoir. Ces groupes étaient vus comme des laissés-pour-compte, des victimes d’un système profondément inégalitaire. Mais aujourd’hui, il faut regarder au-delà de ce prisme réducteur. La violence et le mépris, loin de se limiter aux bidonvilles et aux faubourgs déshérités, se retrouvent aussi dans les bureaux climatisés, les entreprises prospères, et même les arènes politiques.
Comment comprendre qu’un fonctionnaire détourne les maigres ressources publiques ou qu’un commerçant prive intentionnellement ses clients de produits vitaux ? Comment expliquer qu’un compatriote jubile face aux expulsions massives d’Haïtiens de l’étranger ou devant les déboires d’un autre ? Cette attitude trouve ses racines dans un mépris généralisé : celui de l’Haïtien pour ses semblables.
Un virus de mépris
La fracture sociale est souvent attribuée au mépris historique des élites à peau claire envers la majorité noire. Mais le mépris et la haine ne s’arrêtent pas à ce clivage. Ils se diffusent entre riches et pauvres, entre ceux de la diaspora et ceux qui restent au pays, entre les instruits et les analphabètes. Le phénomène est endémique.
Selon le journaliste et économiste dominicain, Euri Cabral, Trujillo et Balaguer étaient d’ascendance haïtienne. Pourtant, ils ont été ceux qui ont fait le plus montre de haine et de mépris envers les Haïtiens.
On en vient à se demander si cette haine n’est pas le résultat d’un traumatisme collectif jamais surmonté, un héritage empoisonné de siècles de colonisation, d’esclavage et de néocolonialisme. L’assassinat de Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de la nation, marque symboliquement le début de ce cycle d’autodestruction. Depuis lors, les Haïtiens semblent incapables de construire une unité nationale durable, préférant s’entre-déchirer sous les applaudissements des puissances étrangères qui, souvent, jouent les marionnettistes.
Changer de paradigme
Une société où la haine est la norme ne peut produire que le chaos. Haïti, autrefois symbole de résistance et de liberté, est aujourd’hui au bord de l’effondrement moral et institutionnel. Il est urgent de rompre avec cette spirale de mépris et de violence.
Le changement commence par une introspection collective et une rééducation sociale. L’histoire de Dessalines nous rappelle que l’unité et le respect mutuel sont les fondements d’une nation forte. Il est temps d’enseigner cette vérité dans les écoles, de la promouvoir dans les médias, et de la vivre dans les communautés.
Les dirigeants, les intellectuels, les entrepreneurs et les citoyens ordinaires ont tous un rôle à jouer. Il faut réapprendre à se respecter, à valoriser les différences, à reconstruire un tissu social qui permette à chacun de contribuer au bien commun.
Quand pourra-t-on renverser la vapeur ? Ce jour viendra lorsque chaque Haïtien, où qu’il se trouve, refusera de haïr son semblable et choisira plutôt de bâtir avec lui. C’est le seul chemin pour refonder Haïti sur des bases solides et durables. La route sera longue, mais elle est la seule issue pour une nation en quête de rédemption.
Nicole Théodore