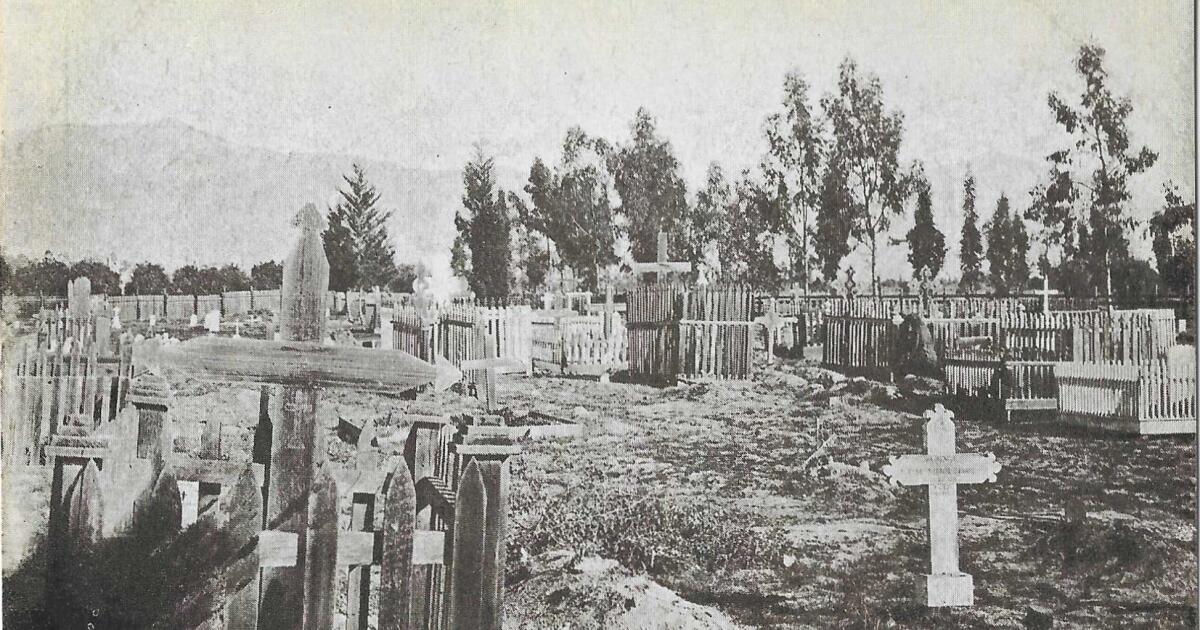Critique de livre
Pas de place pour enterrer les morts
Par Karina Sainz Borgo
Maison aléatoire : 256 pages, 26 $
Si vous achetez des livres liés sur notre site, le Times peut percevoir une commission de Librairie.orgdont les redevances soutiennent les librairies indépendantes.
Dans une ville fictive non loin de la frontière d’un pays d’Amérique latine sans nom, une femme nommée Visitación Salazar s’est donné pour mission de fournir un lieu de repos aux morts malchanceux, ceux qui ont été abandonnés ou dont les familles n’ont pas les moyens d’enterrer. eux ailleurs. Le Pays Tiers, comme on appelle son cimetière non officiel et non autorisé, devrait être un lieu de miséricorde où le rituel de l’enterrement apporte du réconfort. Mais malgré tous les efforts de Visitación, c’est aussi un lieu de violence ; les terres appartiennent à un puissant homme d’affaires, Abundio, et sont recherchées par les irréguliers, une armée de guérilla qui sème la terreur et vend de l’héroïne pour financer sa lutte contre l’État.
C’est dans cette situation tendue qu’intervient Angustias Romero, le protagoniste du deuxième roman de la journaliste vénézuélienne Karina Sainz Borgo, « No Place to Bury the Dead », traduit de l’espagnol par Elizabeth Bryer. Comme le premier roman de l’auteur, « Il ferait nuit à Caracas », il tourne autour du chagrin et de la maternité, mais cette fois du point de vue de la mère plutôt que de celui de la fille.
Angustias n’était pas censé finir dans un pays tiers. Elle et son mari ont quitté leur maison dans un endroit décrit comme les montagnes de l’Est pour échapper à un fléau d’amnésie qui balayait leur région – faisant écho à une épidémie similaire dans « Cent ans de solitude » de Gabriel García Márquez – et laissant la population désorientée et désespérée.
« Des hommes sont sortis dans la rue pour attendre », raconte Angustias. “Pour quoi? Je ne l’ai jamais su. Nous, les femmes, avons fait tout ce que nous pouvions pour contenir le désespoir : nous rassemblions de la nourriture, ouvrions et fermions les fenêtres, grimpions sur les toits, balayions les terrasses. Nous avons accouché en poussant et en criant comme ces folles à qui personne ne propose même une gorgée d’eau. La vie se concentrait en nous, dans ce que nous étions jusque-là capables de retenir ou de repousser.
La force des femmes – terrible, tragique et, dans les circonstances les plus désastreuses, nécessaire – est soulignée tout au long du livre. En effet, il faut beaucoup de force à Angustias pour quitter le lieu ravagé par la peste qu’elle connaît. Mais elle s’inquiète pour ses jumeaux, nés très prématurément et avec une malformation cardiaque, et espère qu’en allant vers l’ouest, ils seront en sécurité.
Au lieu de cela, les bébés meurent peu de temps après avoir traversé les montagnes, c’est ainsi qu’Angustias finit par chercher Visitación. Une fois les garçons enterrés au cimetière, elle insiste pour y rester pour être près d’eux. Elle gagne sa vie en mélangeant du ciment pour les caveaux que Visitación construit pour les morts et, au fil du temps, apprend également à nettoyer et à préparer les corps pour les tombes.
L’intrigue du roman suit la menace existentielle croissante qui pèse sur le tiers pays et ses gardiens alors que le cruel et avide Abundio envoie ses laquais après eux et que les irréguliers font de plus en plus connaître leur présence par des menaces et de la violence. Les pouvoirs qui convergent pour faire sortir Visitación et ses morts de la terre sont immenses. Pourtant, les deux femmes restent fortes : Visitación par entêtement et par sens du dessein divin, Angustias par le chagrin qui la lie à la tombe de ses fils.
Pourtant, l’intrigue n’est pas vraiment le but de « No Place to Bury the Dead », qui s’attarde souvent sur des moments calmes de douleur, montrant les petites façons dont une crise migratoire prive les gens de leur dignité.

A Mezquite, la ville la plus proche du cimetière, des centaines de migrants attendent à la mairie d’être relogés. À Cucaña, à une soixantaine de kilomètres plus près de la frontière, toutes les femmes ont la tête terriblement tondue – ce qu’Angustias remarque parce qu’elle était coiffeuse avec son propre salon dans son ancienne vie – après avoir vendu leurs cheveux pour une somme dérisoire. N’ayant que peu d’autres possibilités de récolter de l’argent, les femmes de la ville se tournent vers le travail du sexe, tandis que les filles s’occupent de la garde des enfants et récupèrent des objets à vendre. Quant aux hommes et aux garçons, ils semblent rarement d’une grande utilité.
Les représentations de Sainz Borgo ont des dimensions troublantes. Visitación, une femme noire évangélique de 60 ans qui boit, fume, a plusieurs petits amis et aime exhiber son corps, peut être interprétée comme une caricature pour certains. Críspulo, un ouvrier agricole indigène qui travaille pour Abundio, est horriblement maltraité, mais en conséquence, d’une manière caricaturale.

Karina Sainz Borgo
(Jeosm)
En même temps, l’évolution d’Angustias est émouvante, son aciérie délicate et tranquille contrastant merveilleusement avec la personnalité grande, bruyante et insistante de Visitación. À la fin du livre, Angustias aborde la relation étrangement exclusive de Visitación avec les habitants du cimetière qu’elle appelle « Mes morts » :
« Il y avait une et une seule vérité, et rien ne pouvait la changer : tous ces hommes et ces femmes étaient morts, et ils ne reviendraient jamais. C’était la seule chose sûre, et il n’y avait rien que Visitación ou qui que ce soit puisse faire pour y changer. Les morts n’étaient pas les siens. Ils n’appartenaient pas à ceux qui les maudissaient ou les désiraient ardemment. Même mes fils ne m’appartenaient pas entièrement, même si c’était la raison pour laquelle j’étais resté ici.
Ce roman sert finalement de méditation profondément ressentie sur la migration, le deuil et l’enchevêtrement et l’éloignement simultanés des vivants et des morts.
Ilana Masad est critique littéraire et culturelle et auteur de « All My Mother’s Lovers ».